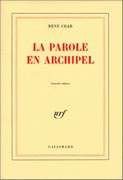« Débander la théorie queer », un livre de Sheila Jeffreys : Par Elaine Audet
Unpacking Queer Politics, Cambridge UK, Polity Press, 2003.
Par Elaine Audet
Mise en ligne le mardi 1er février 2005 sur http://multitudes.samizdat.net/spip.php ?article1886
C’est dans un contexte d’expansion du courant queer dans les grandes capitales et au sein des universités qu’a été publié en 2003 l’essai critique de Sheila Jeffreys, professeure de science politique à l’Université de Melbourne en Australie, dont le titre Unpacking Queer Politics (1), pourrait se traduire littéralement par Débander la théorie queer. Dans les années 90, on a assisté au sein de la communauté lesbienne au phénomène du « packing », nom donné au port d’un godemiché sous le pantalon afin de simuler l’existence d’un pénis. Cette pratique, note Jeffreys, révèle chez ses adeptes le culte de la virilité et l’abandon de la lutte féministe contre les rapports hiérarchiques de genre.
Au départ, le terme « queer » (pédé) était une insulte homophobe. Le courant queer a repris par dérision l’appellation à son compte et regroupe celles et ceux qu’on a accusé-es de perversité, de déviance, les parias, les inclassables qui vivent dans les marges de l’identité sexuelle et de la normalité. On y retrouve des transsexuels, des bisexuels, des adeptes du sadomasochisme, du fétichisme, de l’automutilation corporelle, de la pédophilie.
Ce courant originaire des États-Unis a fait irruption partout dans les années 80-90. Au Québec, on se rappellera l’engouement pour les outrances de l’universitaire américaine Camille Paglia, les spectacles de la star porno Annie Sprinkle et le livre de Nathalie Collard et Pascale Navarro, Interdit aux femmes - Le féminisme et la censure de la pornographie qui se porte à la défense de la pornographie (2). Et, plus récemment, le livre d’Élisabeth Badinter, Fausse route (3) qui fait aussi la promotion de la libéralisation de la sexualité en dénonçant le « nouvel ordre moral féministe ».
On voit apparaître un peu partout les bars fétichistes et sadomasochistes, la mode du cuir, des chaînes, du piercing et du tatouage, la vogue des drag queens, du transsexualisme, les automutilations publiques de groupes comme Jackass et le défilé de la fierté gay qui consacre la récupération commerciale du mouvement contestataire gay et lesbien des années 70.
En 1998, dans la mouvance du post-modernisme et du néolibéralisme dominant, un collectif sous la direction de Diane Lamoureux publie Les Limites de l’identité sexuelle (4), qui définit le queer comme une libération individualiste de toute forme d’identité contraignante et limitative. La même année, lors du congrès de l’ACFAS, Line Chamberland s’interroge, pour sa part, sur la remise en question par le courant queer de la base identitaire du mouvement lesbien et des perspectives féministes de résistance politique à la domination patriarcale.
Sheila Jeffreys, militante de la Coalition contre le trafic des femmes (CATW), a déjà publié, en 1993, The Lesbian Heresy (5), un essai qui dénonce l’emprise de l’industrie du sexe au sein de la communauté lesbienne, le sadomasochisme, la pornographie, les jouets sexuels désormais considérés comme parties intégrantes de la sexualité lesbienne. Elle y signale le regroupement sous l’appellation queer « de s/m, lesbiennes, gay, activistes pédophiles, tout autant que de libertaires socialistes et radicaux plus conventionnels » qui rejettent le lesbianisme « puritain et moraliste » comme une contrainte au même titre que l’hétérosexualité. Le modèle sadomasochiste mis de l’avant par le queer réaffirme, au nom de la libération sexuelle, la primauté du modèle patriarcal dominant/dominée.
Dix ans plus tard, dans Unpacking Queer Politics, Jeffreys montre le cheminement du mouvement lesbien féministe des années 70 jusqu’à son absorption par le mouvement gay et queer des années 80 qui, en choisissant de parodier la virilité et la féminité dans les rapports butch-femme, de normaliser la violence et l’autodestruction dans des rapports sexuels sadomasochistes entre femmes, reproduit les rapports patriarcaux de domination masculine et de subordination féminine qu’ont toujours combattus les lesbiennes féministes. En agissant ainsi, affirme Jeffreys, le courant queer nie le principe d’égalité dans les relations et les rapports sexuels pratiqué par la communauté lesbienne féministe.
La revendication gay de droits égaux au sein du système patriarcal remplace la remise en question radicale des rapports de pouvoir patriarcaux par les lesbiennes radicales des années 70. Ainsi, la lutte gay pour le mariage, considéré par les lesbiennes féministes comme l’institution patriarcale par excellence, va à l’encontre de leurs principes identitaires fondamentaux, en intégrant dans les relations de même sexe les stéréotypes hétérosexuels qui reflètent les rapports sexuels de domination. À l’instar du travail du sexe, toute sexualité déviante est promue comme un choix transgressif et libérateur, selon le principe du droit de faire tout ce qu’on veut de son propre corps.
Jeffreys montre comment le queer est devenu une immense industrie lucrative, ses membres étant ciblés par le marché de la chirurgie transsexuelle, du piercing, des mutilations corporelles, de la pornographie, des vêtements et de la coiffure exprimant l’identité butch, femme ou drag queen, la multiplication des bars spécialisés, etc. Le queer valorise la masculinité et, les lesbiennes qui en font partie, au lieu d’affirmer leur identité de femme lesbienne, cherchent à devenir semblables aux hommes par tous les moyens jusqu’à l’utilisation de la chirurgie et de la prise d’hormones qui les convertira en hommes, seule identité acceptable dans la perspective queer.
Pour justifier le viol, on prétend que la violence fait partie inhérente de la sexualité. Pour le courant queer, les rapports de pouvoir sont à la base du plaisir. Plus les rapports sadomasochistes sont poussés, plus le plaisir est grand. Dès lors, rien d’étonnant à ce qu’on y ridiculise les lesbiennes féministes en les traitant de puritaines, de politiquement correctes et d’anti-sexe.
Incompatibilité entre lesbiennes féministes et queer
Selon Jeffreys, la théorie queer apparue dans les années 70 allait à l’encontre des principes de libération des gay et lesbiennes féministes et marquait un ressac quant à la possibilité d’un changement social radical. La plupart des écrits queer tentaient d’intégrer les lesbiennes et les gay dans une théorie de la citoyenneté sexuelle qui reposait sur la subordination des femmes et l’élimination de tout point de vue féministe.
Le retour à une sexualité hypervirile serait une réaction à la stigmatisation vécue par les homosexuels qualifiés d’hommes manqués, d’efféminés. Le mouvement gay, composé d’hommes blancs, de classe moyenne, avec une minorité de lesbiennes et de personnes de couleur, donna petit à petit la primauté aux seuls problèmes vécus par les hommes gay et abandonna l’analyse de l’oppression, qui l’animait auparavant, pour se consacrer à la lutte pour l’égalité avec les hétérosexuels et le partage de leurs privilèges, sans remettre en question la suprématie masculine.
Les lesbiennes féministes se retirèrent vite de ce nouveau courant ne se reconnaissant pas dans le modèle masculin agressif de liberté sexuelle basé sur des rapports sexuels multiples et impersonnels dans les lieux publics, les toilettes, les saunas, les bars etc. D’autre part, elles jugeaient insultante l’imitation exagérée par les drag queens des pires stéréotypes féminins, conséquences même des rapports de domination et d’inégalité vécus par les femmes.
L’amour des femmes prôné par les lesbiennes n’avait pas de place dans la théorie queer et, bientôt, celles qui demeurèrent dans ce mouvement ne se contentèrent plus de jouer le rôle de butch, mais entreprirent de se transformer, non seulement en hommes mais en hommes gay, en subissant des opérations mutilantes et en prenant de la testostérone.
Dans les années 80, des lesbiennes, comme Gayle Rubin, se mirent à faire campagne pour défendre la pornographie soit au nom de la liberté d’expression, soit parce qu’elles voulaient la rendre accessible aux femmes. Rubin considère que les féministes sont intégrées à la société hiérarchique dominante et doivent être traitées comme des ennemies. Dans Penser le sexe (6), elle poursuit son apologie de toutes les minorités sexuelles dissidentes et se concentre surtout sur la défense de la pédophilie en refusant d’y voir une forme d’exploitation sexuelle. Pour elle, toute loi visant à régir la sexualité constitue « un apartheid sexuel » destiné à renforcer les structures du pouvoir en place. Jeffreys montre que la sexualité est le point de divergence fondamental entre le féminisme lesbien et le courant queer.
La masculinité étant considérée la plus haute valeur au sein de la culture queer mixte, l’amour des femmes est mal vu et celles qui s’en réclament sont traitées de « politiquement correctes ». Jeffreys remarque que le courant queer n’a jamais remis en question le système patriarcal et a capitulé devant les impératifs économiques de l’époque. Des pratiques résultant de l’oppression sexuelle sont mises en marché par la promotion des bains publics, des bars, du piercing, de la chirurgie transsexuelle. Un nouveau secteur économique gay tire d’énormes profits de l’industrialisation de la pornographie et de la prostitution.
Les travaux de Foucault, en développant la notion de « transgression », fournissent une base théorique populaire au courant queer. Jeffreys constate que le philosophe français, gay et sadomasochiste, n’a cependant pas jugé bon d’inclure l’expérience spécifique des femmes dans sa réflexion sur la sexualité et l’homosexualité. Pour Judith Butler, penseuse importante du queer, la transgression au niveau de l’habillement et de la représentation est révolutionnaire et capable de renverser les rapports sociaux fondés sur le sexe. De son côté, Jeffreys montre que la volonté postmoderne de refuser toute certitude identitaire a été utilisée par des théoricien-nes queer pour signer l’arrêt de mort du lesbianisme. Pour elle, la théorie queer vient d’un courant historique anti-libération, individualiste, anti-matérialiste et sexiste.
La commercialisation néolibérale de la sexualité
Jeffreys cite Max Kirch (7), pour qui la théorie queer rend impossible toute transformation sociale, par l’importance accordée à la fluidité de l’identité et à la relativité de toute expérience. Il y voit la conséquence et la défense d’un stade particulier du capitalisme qui requiert l’existence d’individus repliés sur eux-mêmes afin d’atteindre ses objectifs économiques de profits au moyen de la croissance illimitée de la production et de la consommation. Selon Kirch, la théorie queer déconstruit la collectivité, encourage l’indifférence politique et relativise la sexualité et le genre.
Ce qui était, il n’y a pas si longtemps une communauté gay ou lesbienne est maintenant devenu un secteur commercial. Dans certains milieux, le queer est commercialisé par le « piercing », le cuir, les coiffures en pics. Les privilèges de classe et la glorification du capitalisme font partie intégrante de l’industrie queer. Plusieurs universitaires écrivent sur ce fétichisme consommateur et inventent un discours queer qui reflète leur dépendance envers la mode et la consommation de masse.
La chirurgie transsexuelle de femme en homme (FTM) rapporte beaucoup. On en estime le coût entre 50 000 $US à 77 000 $US, un coût qui repousse beaucoup d’aspirantes vers des charlatans et des vendeurs d’hormones illégaux. Il donne aussi à penser que les profits des compagnies pharmaceutiques et des chirurgiens sont des facteurs importants pour expliquer la promotion contemporaine de la transsexualité comme solution pour les lesbiennes malheureuses.
On assiste à l’introduction du capitalisme dans des activités sexuelles pratiquées par les hommes gay depuis des décennies. Le culte de la virilité avait besoin de cette commercialisation pour s’enraciner et prendre de l’expansion. C’est ainsi qu’on s’est mis à faire la promotion d’un « style de vie rebelle ». Le discours sur la liberté sexuelle est appuyé par des forces commerciales puissantes (propriétaires de bars, de bains publics, producteurs de porno) qui visent à tirer un profit maximal de la sexualité gay. Ce sont les intérêts commerciaux qui ont transformé le comportement sexuel gay d’avant les sorties du placard (coming out) en un marché lucratif à travers la création de lieux publics d’échanges sexuels.
Les échanges sexuels ont lieu sur la place publique, dans les toilettes, les parcs, dans les salles arrières des bars ou des librairies, où il y a des isoloirs à cet effet, dans les saunas et bains publics, les clubs qu’on a modelés souvent en forme de toilettes ou d’autres terrains de drague. Le sexe public signifie en général l’exploitation sexuelle en vue du profit, soit des hommes gay eux-mêmes, qui paient un espace pour avoir des rapports sexuels entre eux ou d’hommes et de garçons qui sont payés pour leurs services sexuels dans la prostitution et la pornographie.
On peut comprendre pourquoi, dans un tel contexte, des promotrices du queer, comme Gayle Rubin et Pat Califia, s’attaquent au « féminisme moraliste » qui s’oppose à la pornographie, à la pédophilie, au sadomasochisme et aux rapports sexuels publics.
Le mariage et le droit aux autres privilèges hétérosexuels
Jeffreys explique clairement pourquoi est contraire aux intérêts des lesbiennes et des femmes en général un projet d’égalité gay qui cherche à tenir hors de toute analyse politique une sphère « privée » d’exploitation sexuelle, tout en demandant un accès égal aux privilèges hétérosexuels, indissociables de la subordination des femmes. L’égalité dans le domaine public ne peut découler de l’esclavage « privé ».
Un autre point commun entre le mouvement de libération gay et celui de libération des femmes des années 70 consistait à remettre en question le mariage et la famille nucléaire. Les deux mouvements considéraient le mariage comme un contrat légalisant l’exploitation et la domination masculine parce qu’il reposait sur la division sexuelle inégale des rôles. L’essayiste rappelle que le mouvement de libération gay, loin de plaider pour le droit au mariage, le remettait radicalement en question comme une forme d’oppression. Ainsi, le courant actuel gay pour l’égalité est fort problématique puisqu’il implique les fondations mêmes de l’oppression historique des femmes et revendique, notamment, le droit pour les hommes gay de se marier, incluant celui d’acheter le ventre de mères porteuses afin de pouvoir se reproduire.
Une perspective féministe lesbienne considère au contraire qu’une telle possibilité ne devrait être permise à qui que ce soit, parce qu’elle s’appuie spécifiquement sur l’exploitation des femmes et la perpétue. Alors que le mariage gay défend une institution oppressive, l’utilisation gay de mères porteuses entérine directement l’oppression des femmes.
Les mères porteuses sont des ramifications de la lucrative industrie des technologies de reproduction. Les théoriciennes et militantes féministes ont lutté contre la mise en marché de ces technologies, parce que leurs procédures sont nocives pour les femmes, qu’elles en sont au stade expérimental et que les chirurgiens n’ont souvent d’autres expériences que sur les vaches et se servent des femmes comme cobayes. Ainsi, le corps des femmes et des enfants est mis en marché, comme le dénonce Janice Raymond dans son essai sur l’esclavage de la reproduction (8).
L’argent est probablement la raison pour laquelle ces femmes acceptent d’être des mères porteuses. La femme reçoit 18 000 US $ pour porter le bébé, en plus d’un bonus pour les procédures envahissantes d’insémination. En fait, il s’agit d’une entreprise commerciale de vente d’enfants, protégée contre celles qui tenteraient d’abandonner le projet en cours de route, leurs intérêts et ceux de leurs enfants ne pesant pas lourd. Au lieu de s’en réjouir, il faudrait s’inquiéter du fait que des hommes gay participent dans cette mise en marché du corps des femmes. Le droit à l’égalité dans l’exploitation sexuelle est une voie qui est en contradiction directe avec les intérêts des femmes.
Dans plusieurs pays, les femmes continuent à être achetées et vendues dans le mariage et, dans la plupart des pays du monde, leurs corps continuent d’appartenir légalement à leurs maris. Avec la prostitution et la pornographie, la commande d’épouses par la poste et l’industrie des mères porteuses, la marchandisation des femmes est une industrie en pleine expansion.
Les femmes engagées dans des relations lesbiennes ont déployé une somme considérable d’énergie dans la création de façons inédites de se lier sans recourir à un scénario de jeu de rôles. Jeffreys cite John Stoltenberg (9), auteur gay, pour qui : « Un mouvement politique qui tente d’éradiquer l’homophobie en laissant intacte la suprématie masculine et la misogynie ne saurait fonctionner. » La théorie queer fait disparaître les lesbiennes sous le terme générique « queer » et entraîne ses adeptes lesbiennes à répudier la féminité et le corps féminin au point de devenir des hommes. Pour l’auteure, il est de la plus haute importance de prendre conscience que l’expansion actuelle d’une pratique sexuelle intime de domination et de soumission dans des secteurs de plus en plus nombreux de la sphère publique est contraire aux intérêts de l’ensemble des femmes.
Le féminisme lesbien comme alternative de transformation sociale
Pour Jeffreys, l’adoption par les lesbiennes d’un terme spécifique, définissant les femmes qui aiment les femmes, a été crucial dans l’affirmation de leur existence et de leur différence. Le terme « lesbiennes » définit leur fierté de ne pas représenter une espèce inférieure d’homme gay, mais des femmes insoumises et rebelles qui refusent toute subordination. En fait, les féministes lesbiennes ont lutté beaucoup durant vingt ans pour mettre sur la carte politique ce terme qu’elles ont choisi pour exprimer leur histoire, leur culture, leur pratique et leur pensée spécifiques.
Les lesbiennes féministes considèrent qu’il ne saurait y avoir de libération qu’en détruisant le pouvoir des hommes sur les femmes. Les principes du féminisme lesbien, qui se distinguent clairement de la théorie queer d’aujourd’hui, sont l’amour des femmes, une organisation, une communauté et une pensée autonomes, la conviction que le lesbianisme est une question de choix et de résistance, que le personnel est politique. Le féminisme lesbien est une critique radicale de la sexualité basée sur la suprématie masculine et l’érotisation de l’inégalité, il rejette sans équivoques les rapports de pouvoir sous forme de jeux de rôles et de sadomasochisme qui sont la marque de commerce du courant queer.
Dans cet essai critique d’une grande perspicacité, traversé par une révolte non dénuée de compassion pour celles et ceux qui se sont laissé abuser par ce mirage sinistre de toute-puissance, Sheila Jeffreys a su exposer un à un tous les intérêts en jeu, tant économiques qu’idéologiques, derrière le développement de la culture queer et de son discours de libération qui ne fait, en réalité, que perpétuer la suprématie masculine et les rapports sexuels de domination. Elle montre clairement que ce n’est pas de cette sexualité autodestructrice et violente dont les lesbiennes et l’ensemble des femmes ont besoin, mais de rapports amoureux fondés sur l’égalité afin d’en finir avec l’exploitation sexuelle et d’être capables de décider librement de leur vie.
Notes :
(1) Sheila Jeffreys, Unpacking Queer Politics, Cambridge UK, Polity Press, 2003.
(2) Nathalie Collard et Pascale Navarro, Interdit aux femmes - Le féminisme et la censure de la pornographie, Montréal, Boréal, 1996.
(3) Élisabeth Badinter, Fausse route, Paris, Odile Jacob, 2003. ( 4) Diane Lamoureux (dir.), Les limites de l’identité sexuelle, Montréal, Remue-ménage 1998.
(5) Sheila Jeffreys, The Lesbian Heresy, Melbourne, Spinifex Press, 1993.
(6) Gayle Rubin, Penser le sexe. Pour une théorie radicale de la politique de la sexualité, Marché au sexe, EPEL, 2001.
(7) Max Kirch, Queer Theory and Social Change, London and New York, Routledge, 2000.
(8) Janice G. Raymond, Women as Wombs, Melbourne, Spinifex Press, 1993.
(9) John Stoltenberg, « Gays and the propornography movement : having the hots for sex discrimination. » In Michael S. Kimmel (ed.), Men Confront Pornography, New York, Meridian, 1991.
Suggestions de Sisyphe
Bourcier, Marie-Hélène, « Foucault et après : théorie et politiques queers, entre contre-pratiques et politiques de la performativité », dans Queer zones : politiques des identités sexuelles, des représentations et des savoirs, Paris, Balland, p. 175-194.
Bourcier, Marie-Hélène, La fin de la domination (masculine) : pouvoir des genres, féminismes et post-féminisme queer, 2003. Voir le site : multitudes.samizdat.net
Butler, Judith, Gender Trouble : Feminism and the Suversion of Identity, New York, Routledge, 1990.
Califia, Pat, "A secret side of lesbian sexuality/. In Pat Califia, Public Sex, The Culture of Radical Sex, Pittsburgh and San Francisco, Cleis Press, 1994, 157-64. Jagose, Annamarie, Queer Theory : An Introduction, New York, New York University Press, 1996.
Rue Descartes, Queer : repenser les identités
Sedgwick, Eve Kosofsky, « Construire des significations queer » dans Didier Éribon (dir.), Les études gay et lesbiennes, Paris, Éditions du Centre Pompidou, p. 109-116.
vendredi 16 novembre 2007
« Débander la théorie queer », un livre de Sheila Jeffreys : Par Elaine Audet
F (emale) to L (esbian) Pour un nouveau genre de visibilité
F (emale) to L (esbian) Pour un nouveau genre de visibilité
Communication au colloque lesbien de Rome, mai 2005 : "le sujet lesbienne. Subvertir la pensée hégémonique pour une récriture de symbolique"
Jacqueline Julien
Résumé
Il y a de quoi se demander : pourquoi le CORPS lesbien, s’étant visibilisé et montré dans toute sa "fierté" au long de fiers défilés, disparaît ensuite régulièrement de la scène sociale et du champ symbolique ? A moins qu’on ne le fasse disparaître ?
Mais de quelle disparition s’agit-il ? Et disparition de quelle idéale idée d’identité ?
Si l’on évoque celle qui s’efface dans la course gaie à l’homologation, celle qui se fond dans la sexision female, ou se réduit à 1/4 de portion dans l’occulte sigle LGBT, la voici, notre corporéité lesbienne, pourtant unique dans son potentiel d’implosion des catégories de sexes, rétrécie au summum de l’effacement : la lettre L.
Mais qui est L . Comment avons-nous pu permettre une telle dilution ? Il ne s’agit pas seulement de poser les questions mais d’y répondre, et vite si nous voulons reproposer celle de notre visibilité - donc de l’eternel retour à l’invisibilité - , en somme si nous ne voulons pas souscrire au contrat homohétérosocial qui structurellement nous anéantit.
Je me propose d’introduire mon intervention avec ces deux composants : la colère et le pessimisme.
Naturellement j’essaierai de montrer que mon pessimisme est étroitement surveillé par ma colère , puisque c’est la colère qui anime - et j’ajoute nécessairement - mon pessimisme. Nécessaire plus que jamais, la colère. À mes yeux aujourd’hui dénutrie , dans ce que nous-mêmes appelons communauté lesbienne. Nous devons accomplir à nouveau beaucoup d’efforts pour accéder collectivement, donc singulièrement, "l’une après l’autre" , à un état de fureur permanent.
Paradoxalement, nous aurons plus de mal à remobiliser cette colère du fait qu’elle a déjà été éprouvée et agie (année 70-80-90), et ensuite nous l’avons en partie perdue (début de la fin des années 90) (1) . Il nous faudra donc également affiner, radicaliser notre pessimisme, qui donne à voir cette perte. Les deux composants , colère et pessimisme, je le précise, ne sont pas contradictoires. Aujourd’hui, ils sont dialectiques, et tactiques.
Depuis un certain nombre d’années, la fureur lesbienne fuit. Elle fuit par le haut (les Anciennes sont fatiguées ou casées ou mortes), par le bas (les Nouvelles sont enthousiastes et/ou inconscientes, ou au contraire inexistantes car trop opprimées) et par le milieu, comme chez les lesbiennes gay-ysées ou queerisées que j’appellerai domestiquées.
Mais il y a sûrement des espaces où on peut encore trouver cette fureur. Non ?
Par fureur j’entends une fureur volontaire, facile d’accès et non autodestructrice, à condition qu’elle soit armée du même poids de jubilation radicale, à condition de l’étayer par notre ardeur à " réinventer le monde " . la fureur est la base mentale nécessaire à toute action d’éclat, préalable à tout labeur de réécriture de l’existant. Quant au pessimisme, il n’est pas une résignation, n’est pas un lamento d’Ariane, ce qu’il serait sans la colère. Il n’entrave nullement des fonctions vitales comme rire aux éclats (le rire de la Méduse ?), faire l’amour- seule ou accompagnée-, ni ne vous prive de cultiver des plantes en pots sur votre balcon.
Le pessimisme ne doit pas être un épouvantail, au contraire : contre l’épouvante du demain, il nous permet de nous ériger, menaçantes car indignées, luttant stratégiquement contre ce que nous révèlent nos pires cauchemards : la réalité d’aujourd’hui.
Toutefois, pour être vraiment fonctionnel, notre pessimisme a besoin, à part être furibond, d’être lubrifié par une autre huile essentielle : la lucidité, je dirais même la volonté de lucidité. (NB : " lucide ", de lucidus, eut le premier sens de clair, lumineux ; et la " lucidité " fut d’abord synonyme- fin XVe s. - de gloire et d’éclat.)
Puissions-nous retrouver éclat et gloire dans l’exercice de la lucidité ? Or si je veux parler de cette " réalité d’aujourd’hui " - ce qui demande lucidité, cette fois au sens de clairvoyance, perspicacité -, je ne peux le faire sans pessimisme, voire désespoir. Et s’il nous faut contrer ce réel du jour qui est celui de demain, j’estime que nous, lesbiennes ayant soi-disant conquis la fierté de l’être avons besoin surtout, ici et maintenant, de désespoir. Et cela afin de RE-agir. (Nous verrons ensemble de quel ordre et où : localement ? nationalement ? ou au moins au niveau européen - en attendant mieux ?)
Ayant formulé cela, je suis consciente de provoquer quelque remous. mon discours sera incompréhensible à qui oublie de quelle phénoménale en-rage nous provenons, ou à qui estime que nous avons conquis des droits et qui pour cela trouve des raisons d’être confiante quant au partage final et global de tous les privilèges de l’hétérosociété.
Nous avons peut-être cru car espéré être devenues socialement visibles parce que nous avons défilé sous l’arc-en-ciel de la fierté (Gay & ) lesbienne. ces défilés n’ont pas été inutiles. Les premiers ont même été une réelle ébriété, à nous voir ainsi nous voyant , toutes et chacune, ô dykes, à l’air libre. ces fiertés ont eu aussi, bien entendu, leur fonction d’électrochoc dans l’establishment hétérolobotomisé ; d’ailleurs, si l’on pense aux pays infiltrés/gouvernés par un fondamentalisme religieux d’Etat, comme la Pologne, impossible de nier qu’une manifestation gay et lesbienne y assume son pouvoir de subversion et d’éveil (et il fallait les entendre et les voir, les huées de haine contre la Pride de Cracovie en 2004, pour se rappeler ce que c’est, une " Pensée hégémonique " en action... ) Désormais, à l’ouest, nous sommes LGBT, et je ne doute pas que les dykes polonaises accéderont sous peu à un tel privilège (2).
Hélas, les initiales de ce nom de code, contenants évacués de leur contenu, traduisent l’érosion du vouloir révolutionnaire, ne manifestant au mieux qu’un potentiel subversif contre l’ordre moral. Mais le lesbianisme est bien plus qu’une subversion de l’ordre moral. Dans cette " fierté " mixée aux consones cryptées, les lesbiennes, comme d’ailleurs leurs collègues GBT, sont dé-nommées, de-substantivées en épithètes ; et même pas, car si en grec epitheton signifie " ajouté " , l’épithète qualificatif lesbienne a même disparu, désormais réduit à cette initiale, à cette seule et muette majuscule : L. Soit le 1/4 de portion du fameux sigle fédératif ( pour fédérer quoi au juste ? ) et abusivement consensuel (pour quel consensus may I ask ? )
Tout cela n’est pas sans conséquences.
Mais qui est L ?
A l’heure actuelle n’est à voir dans cet L que ce qu’il n’est pas mais qui " saute aux yeux " si on peut le dire - d’une disparition : effet escamotage dans le mixage queerisé des objectifs gay-les-bi-trans, L traduit une caméléonique invisibilité sociale, donc économique, donc politique, donc culturelle, parce que linguistique, donc symbolique. Et j’ajouterais " graphique " . Donc tragique. Quant à l’histoire, fût-elle récente, " (...) ne dites pas, il y a eu des périodes de chaos. Comme si nous avions connu d’autres temps. Âge sombre après âge sombre, telle a été notre histoire. " Ainsi admonestaient Monique Wittig et Sande Zeig (pour la définition du mot histoire) dans le Brouillon pour un dictionnaire des amantes. C’était en 1976. Dans La Pensée straight (3) , Wittig réitérait son indignation, volontairement pessimiste, évidemment lucide et se donnant les moyens de l’être en glorieuse éclatante : " Il n’y a aucun doute, une guerre a été entreprise contre le lesbianisme. La destruction systématique des textes issus de cette culture, la clandestinité dans laquelle elle a été plongée l’attestent " .
Contre cela, cette suppression suprême et principielle (nier toute culture aux dominé-es est la stratégie princeps, et qui plus est durable), ne devrions-nous pas être animées d’une rage cosmique ? Non, si l’on contemple notre incapacité tactique, évidemment empreinte de lassitude, à stopper net la vague légaliste de l’homologation lesbienne (L) réclamant son bon droit d’exister (de disparaître) dans l’hétéro-homosocialité (4) . Le déplorable manque de colère qui caractérise l’oecuménisme, ou disons le grand gay brassage LGBT, nous décourage d’afficher nous-mêmes-s notre colère radicale. Au lieu que nous manifestions d’être révoltées, rageuses, agressives, implacables (je ne parle pas ici d’individues mais de capacité de mouvement), nous laissons courir le courant au titre d’esprit de communauté compatissante, laissons enfler le mainstream des aspirations familialistes des lesbiennes à enfants, de toute cette homolesbitude pacsée domestiquée et gay gay marions-nous (5) . Serions-nous redevenues en lesbianisme ces " filles à papa " vilipendées par Valérie Solanas ?
Il se pourrait même que certaines lesbiennes plus jeunes, celles qui n’ont pas été socialisées par le mouvement féministe mais par les gays, soient entrées de plain- pied dans l’ère du fratriarcat analysé par Rosanna Fiocchetto (6) Voici donc, du moins en France, toute une nouvelle génération de petites-soeurs, zélées ferventes de leurs grands-frères. Contrairement à celles qui, bien que n’ayant pas connu générationnellement le mouvement des femmes des années 70-80, sont, elles, avides de culture lesbienne féministe, les petites-soeurs-des-pauvres - dans ce cas des pauvres gays sidéens, des pauvres trans- (à chouchouter en particulier : les Male to Female , et intersexué-es - ne pensent pas lesbien. mais de même qu’on demandait : " Comment peut-on penser femme à l’ombre des hommes ? " , on est en droit de redemander, avec Brigitte Boucheron : Comment peut-on penser lesbien à l’ombre des homos ?
Tout cela, à savoirentendre, est très fatiguant.
Cette fatigue, elle nous sape le moral, nous ôte la confiance en un possible redéploiement radical, comme si on se croyait incapables politiquement (théoriquement/pratiquement) de contrer avec éclat ce rouleau compresseur consensuel de l’homofratriarchie, inaptes à annuler l’amnésie de la violence hétéropatriarcale et des moyens de cette violence. Nous qui avons défilé en 2003 à Bari (8) , ville du Grand Sud de l’Europe, et qui n’y avons PAS subi de violence violente, voudrions oublier pour autant qu’une des tactiques les plus efficaces du fondamentalisme hétérosocial, quand n’est plus considéré " esthétique " de trucider l’homosexuel-le, est celle de digérer la sédition de ses autres différents ? Naturellement qu’on ne l’a pas oublié. Mais cela ne nous rend pas plus aptes.
Et tout cela nous met (souvent) de mauvaise humeur.
Le problème de la mauvaise humeur, contrairement à une fureur ontologique, c’est qu’elle reste dans l’anecdotique et fait alliance avec la résignation - ce quant-à-soi qui reste chez soi -, le silence. Ainsi, de " silenciées " (mot outil de Michèle Causse), nous voici mutifiées. Disparues du champ sociétal mais participant de cette disparition, clandestines ou dans l’esquive, nous ne savons plus être activistes (ces rebelles " trépidantes, énivrantes " , pour re-évoquer Solanas !), nous ne parvenons pas à transformer notre humeur massacrante en action véritablement " éclatante et glorieuse " . Le fait est, éclat-et-gloire font bien défaut à la lettre L, plutôt éteinte derrière les paillettes des défilés gay-bi-trans : font défaut, certes non pas par " manque " de paillettes et de plumes ! - et qu’on me fasse grâce ici de l’accusation de pudibonderie " normative " : notre REFUS des oripeaux F(emale), fussent-ils de provocation/dérision, est la base et le tout de notre REFUS politique des classes de sexes.
Alors balayons les paillettes et revenons au fait : nous lesbiennes radicales n’avons plus la mine glorieuse-éclatante. Les anciennes, parce qu’elles sont anciennes et fatiguées de projeter leur corps dans un espace public homo/hétéro hostile à leur pensée, ignorant du corpus lesbien ; quant aux Moins Anciennes... elles sont certes moins fatiguées mais l’éclat et la gloire ne sont pas non plus évidents chez elles : se sentant elles aussi minoritaires ou minorisées par l’homohégémonie, elles préfèrent entretenir leurs propres espaces d’alliance et de séparation des corps (9) . séparées, donc, du courant majoritaire... qui le leur rend bien ! Cloison de verre, et pas de forces, assez, pour le faire exploser.
Depuis 40 ans, les Anciennes, rejointes par les Moins Anciennes, écrivent articles et livres implacables. Problème, pour le moins de visibilité puisqu’il s’agit de lisibilité : ces articles, ces livres ne sont ni lus ni traduits, et d’ailleurs peu publiés et presque jamais réédités (10)
Allons, ne parlais-je pas d’un pessimisme qui devrait " se convertir en action " comme l’exigeait Audre Lorde à propos de la colère (11) ? Las, creusons la plaie : " dans le passé, écrivait George Orwell dans 1984, chaque tyranie finissait, un jour ou l’autre, par être renversée, ou au moins combattue, parce qu’ainsi le voulait la nature humaine, éprise comme il se doit de liberté ( ? le point d’interrogation est le mien, nda). Rien ne nous garantit que cette "nature humaine" soit immuable. Il se pourrait tout autant que l’on parvienne à créer une race d’hommes (sic : nous sommes chez un auteur androlectal même si lucide sur certain point pour lequel je le cite, nda) n’aspirant PAS à la liberté, comme on pourrait créer des vaches sans cornes " .
...Comme on pourrait créer des vaches sans cornes
Ma consternation, voyez-vous, est de faire partie demain d’une communauté de vaches sans cornes.
Un : parce que mon amour pour les vaches en souffre.
Deux : parce que je suis au désespoir de ne pouvoir comprendre (ou trop comprendre ?) le sens de cette immolation collective, de cet effacement lesbien (toujours au nom de la solidarité avec les autres-différents) dans le jeu de piste des intertersexué-es et des transgenres. Le lesbianisme à son préalable est tout autre qu’un jeu de classe sexuelle mais bien une guerre déclarée à la bicatégorisation des sexes. je répète, la révolution lesbienne n’oeuvre pas à la seule subversion d’un Ordre moral (prisée surtout par les gais), mais au renversement du mythe de la féminité, au démantèlement des rôles imposés à la différence femelle. Nous avons nous-mêmes initié la démolition théorique de la dualité des sexes - l’enjeu véritable, et non le jeu (ou alors l’en-je), étant de faire rendre gorge à l’héteronorme donc à LA norme, de faire imploser l’hétérosexualité donc LA sexualité, de déminer l’hétérosociété donc LA société. Si chez Wittig, comme chez Causse, le lesbianisme radical opère dans le champ littéraire, c’est qu’il est " le lieu privilégié pour faire advenir un sujet un jour.
Tout cela est très excitant.
Mais voilà un enjeu tellement considérable, pour les lesbiennes et pour les femmes du monde, qu’il y a de quoi se demander si ce n’est pas l’énormité de cette déconstruction/reconstruction révolutionnaire qui a amené certains et certaines à l’éclater, à la compartimenter dans des propositions architecturales apparemment encore plus " osées " , censées être plus expertes à déconstruire le mono/logos, la monolithique loi des genres ; ces petits bungalows ou mobil-homes, très mobiles en effet, n’offrent en réalité qu’une façade ultra-kitsch. Leur pomponnage post-postmoderne masque dramatiquement et scandaleusement la réalité des fondations du pouvoir qu’elles prétendent défier.
Alors, question : le lesbianisme radical est-il seul capable aujourd’hui de faire sauter la banque ? Cette banque mondiale du sperme qui régit les consciences et où maintenant vont s’approvisionner les goudous en mâle d’enfant ? Je parle cru, car la menace est crue. Et cruelle.
Dans le cadre de la digestion des diversités en un Universel, lequel régit la bicatégorisation des sexes, le complot de l’homologation DES sexualités à LA sexualité est désormais médiatique. (Je dis bien des sexualités y compris lesdites " différences " de la-normale.) Florissante, l’idéologie du nombre Deux, seul horizon du couple fût-il LGBT, s’incruste. (et Danielle Charest décolle cette croûte idéologique, impitoyablement (12) ). On nous sert jusqu’à en vomir de ces documentaires indigents sur nos " histoires de vie " , estampillées au sceau de cette NORME-alitée à deux. On y apprend que les lesbiennes, scoop fracassant, couchent - mais oui couchent, et que certaines sont même acquises au hard sex (Allons, foin de préjugés, semblent insinuer les journalistes avec des airs gourmands de pornographes (13) .) Tandis que les gays bénéficient de l’allusion à une production, ne serait-ce que livresque ou filmique, les lesbiennes n’apparaissent quasiment jamais, dans ces docu-menteurs mortels, comme productrices d’écrit, génératrices de concept ; ni au passé (et de grâce passons sur Sapho qui n’est au mieux qu’une étiquette d’origine controlée, dans le grand public), ni au présent ni au demain.
Face à l’insulte recurrente et l’acculturation systématique (violence inouïe aux rarissimes exceptions, voir note précédente), que faisons-nous ?
Comment démanteler la " tolérance répressive " (expression de Marcuse (14) ) qui suffoque nos écrits, nos voix et a contaminé telle une MST nos amies en homosexualité ? " Voilà pourquoi je suis fatiguée de la tolérance, dit Edda Billi (15) dans un récent communiqué, ce mot sournois qui va jusqu’à nous ouvrir des créneaux dans le balayage médiatique, offrant nos visages et nos corps, exploitant hypocritement nos intelligences comme on exhibe les guenons au zoo." Le dominant nous hait tranquillement le mal nous anéantit mais "ça ne se voit pas " . pire encore, nous ne le voyons pas, puisqu’il paraît que nous sommes (mieux) tolérées.
L’opposé de la lucidité serait donc bien l’oubli des capacités digestives de l’androcratie, l’aveuglement sur la fonction répressive, puisque de contrôle , de la tolérance ; aussi cette partie sur le péril des vaches sans cornes se conclut-elle avec le risque déjà annoncé : l’abandon du désir de liberté.
À l’instar de l’installation mondiale de l’ultralibéralisme et de pensée Unique -pensée inique- un Nouvel Universel s’est insensiblement imposé, persuadant un grand nombre de lesbiennes d’en être les naturelles ayants droit. cette nouvelle universalité de la " différence normale " (16) alliée ou du moins associée des autres-différents caractérise l’homolesbianisme à la sauce mixte. Lequel a abandonné - paradoxe - le désir de liberté alors même qu’il semble réclamer toujours plus de " libertés " : pluriel d’abondance, à la façon de ces énormes packs de supermarché proposés comme plus avantageux et contenant dix fois plus que ce dont on a réellement besoin.
Ainsi les lesbiennes qui se veulent à la fois aussi " normales " que les hétéros (couchant, s’épousant, pondant) mais différentes à l’intérieur d’une " communauté " dominée par les gays, gays-queers, gay-trans, gays-bi, se retrouvent invisibilisées par cette " différence " même. La " différence " ne fait plus la différence ! elle est à la fois rejointe (assimilée) par les " autres-différences " et va se fondre unanimement dans le " Tous-Genres " , défendus au nom même de la subversion des genres. (Performativité ma soeur...) Cela ne fait pas bouger d’un iota l’édifice hétéropolitique, ni ne remet en cause le corps féminin F(emale) obligatoire dans l’hétérosocialité et sa " présomption d’hétérosexualité " , selon la formule de Teresa de Lauretis (17) . Légalistes, Gentilles, Braves et Tranquilles, les lesbiennes " gay-isées " du courant mixte LGBT ont donc été rattrapées par le différentialisme qui régit la société toute entière.
Tout cela nous menace grandement.
Où avons-nous égaré notre pouvoir terrifiant de la lavender menace imaginée par Nicole Brossard, formalisée par Monique Wittig ?
Devrions-nous encore toucher le fond du désespoir, donc atteindre le summum de la lucidité pour enfin RE-agir " méchamment " ?
Contre le Nouvel Universel, casser le fil (du Lamento) d’Ariane
L’idée d’une nouvelle normalité, on l’a vu, est non seulement une voie sans issue, dangereuse comme une impasse la nuit, mais elle est peut-être aussi l’expression d’une nouvelle mélancolie, d’un refus du malheur travesti en désir de jouir. Comme dans toutes les époques de profonde dépression, de crise-de-société, il y a toujours des petits futés qui viennent réclamer avant tout, non pas un salaire égal à compétence égale, mais de " jouir sans entrave " - c’est bien ce que proclamaient non pas les filles, mais les petits mâles de 68, ayant vite saisi les avantages immédiats qu’ils allaient tirer d’une imminente " révolution sexuelle " .
Eh bien tope là, jouissons sans entrave et que la sexualité - to have sex - nous tienne lieu de gaîté, qu’elle anticipe le discours et l’évacue. que le gode soit notre bâton de pèlerin et grossissons le flot des nouvelles converties en Tous-Genres. En magasin, nous avons aussi la tentation du neutre ou de l’androgyne. Allons donc : dépasser l’espace d’indétermination sexuelle et de genre réclamée par les queers, n’offre qu’une marge étroite, car cet espace est extrêmement exigu. Mais déjà dit et redit mille fois par les radicales. Faut-il encore et toujours se répéter ?
" Le procédé qui consisterait à neutraliser tous les termes en employant systématiquement le masculin n’aurait pour résultat, en l’état actuel de la langue, que l’occultation, dans le texte, des femmes et ne ferait que perpétuer la tradition. Se trouveraient évincés du discours, non l’oppression, mais l’opprimée, non le féminin, mais les femmes.(18) "
Et j’ajouterai : évincé, non les genres, mais les lesbiennes. Puisque " le genre est une farce ontologique " (Monique Wittig, La pensée straight) je repose la question :
Qui est L ? De quelle " visibilité " identitaire ou de quel sujet est-elle la lettre d’impasse ?
Est-elle vouée à rester cette " anomalie qui réclame le nom caché " , de Djuna Barnes ? Et nous, ici, oeuvrons-nous toujours dans un projet révolutionnaire incarné ? Et quelle pensée non volatile incarne en 2005 un corps lesbien, plus de trente après la publication du Corps lesbien de Wittig ? (Le concept-image de volatile est emprunté à Causse dans l’interloquée : " Une pensée qui n’est pas soutenue par un corps est une pensée volatile (19) " )
Quel est alors ce "sujet lesbienne " de nos livres implacables ? Quel est même ce " nom " de lesbienne ? Katy Barasc a retravaillé ces questions, qui sont d’ordre philosophique, comme on travaille une pâte reposée sous la haute main de la généalogie (20) . Tout est à reprendre, même les interrogations. d’ailleurs " Il ne s’agit pas de trouver de nouvelles réponses à de vieilles questions (...) mais d’ouvrir les brèches pour un futur vivable (21) ." Le passé n’est pas vivable, on ne le sait que trop. Quant au demain, devrons-nous, comme nous avons porté les corps sanglants des femmes avortées dans l’illicite, porter longtemps le fardeau mental des homosexuelles ?
Oh redonnez-moi la Babel de nos pensées NON volatiles !
" Une lesbienne est radicale ou n’est pas lesbienne, disait ( avec beaucoup d’autres choses) Nicole Brossard. Devrions-nous alors, non pas nous séparer mais nous réparer, et pour cela demander réparation -oh symboliquement- à celles qui nous freinent, les satisfaites, qui nous pèsent et nous retiennent de tout leur ancrage dans la fratriarchie ? Celles, les " excisées mentales ", à qui peu ne chaut, entre autres, des excisées réelles ? Comment redéployer notre agency, notre puissance d’agir ?
Peut-être, nous, Anciennes, oubliant notre fatigue, nous re-exercer à la jouissance ? Triompher de la mise sous silence ou de l’in-signifiance ? retrouver le goût le défi le panache le rien-à-perdre ? Ranimer cette lavender menace que nous représentons et qui nous a tant et tant fait rire ? Notre langue est difficile. Mais " une langue difficile peut changer un monde brutal " - et comment ne pas être d’accord, dans ce cas, avec Judith Butler ! laquelle précise, parlant d’or, qu’une langue remettant en question le sens commun " peut aider à déterminer les voies d’un monde socialement plus juste (22) " . Semble lui faire écho Michèle Causse (mais cela 20 ans plus tôt - elle le disait en 1988 ! ) : "Récupérer le sujet de l’énonciation exige aussi la maîtrise de l’énoncé (23) " .
Alors : Voulons-nous la maîtrise de l’énoncé ? Voulons-nous re-agir sur le SUJET de l’énonciation, au lieu de le laisser être "récupéré " par d’autres, plus pressé-es (cf. " jouir sans entraves " ! ) ou moins scrupuleuses ? Lorsque sous ma bouche la raison du monde ruisselle... (24)
Alors : je... Ou j/e ? Quel en-je ? En tout cas : cette elle en chacune qui disais-je n’a " rien à perdre " , qui peut dire " d’après-moi " ou " en-ce-qui-me-concerne " , cette je-e-là dit que notre désespoir doit sans cesse être réinvesti dans son dépassement.
La dialectique dialogale entre désespoir et colère, entre fureur et jubilation n’est certes pas la voie la plus calme (il m’arrive d’être très-énervée) et le " moi " ne sait parfois plus où donner de la tête, sic.
Mais lorsque sous ma bouche la raison du monde ruisselle ...
C’est aussi avec la poésie que je veux conclure. Revenir au poème : comme pour y protéger la paix au coeur de ma colère. Le faire exprès signifie partager avec vous l’humour nécessaire au désespoir. C’est qu’il ne s’agit pas d’être " à moitié " pessimistes, ni " à moitié " lucides, ni donc " à moitié " furieuses, il faut l’être " à la perfection" .
Comme c’est étrange le
le bruit des explosions dans les cafés
le nombre des martyrs
des illetrés
des buveurs de bière et de thé
le nombre des morts mon amour c’est étrange
deux femmes qui s’aiment dans l’angle
du plaisir fou c’est étrange le plaisir
le nombre des saisons qui diminue
le futur qui rétrécit dans le silence
comme si nous rêvions avec une ardeur
sans nom
pour cogner dans l’histoire
en pleine crise d’espoir
c’est si étrange
le trafic des êtres et des bêtes
les visages, les cornes, les défenses
les sexes
comme c’est étrange
que pour éviter le pire
l’âme laisse les épines se multiplier
dans les ruelles, les bars
les musées et les jardins
c’est étrange comment
tu dis vouloir recommencer à plier par en dedans
la planète pour qu’il y ait
du vent dans les traductions,
qui augmente la passion
comme c’est étrange quand
tu me dis sors de ta solitude
et que je n’entends rien
les yeux branchés sur la nuit
donne-moi une allumette
il fait noir dans notre humanité
C’est étrange, Nicole Brossard, (inédit)
Mon amour, je te la donne cette allumette.
Pour illuminer notre langue.
Notre langue est difficile.
Pour changer un monde brutal.
Notre désespoir sera sans fin réinvesti dans son dépassement.
Jacqueline Julien Rome, mai 2005
[1]
[1] Notes :
1-Sur l’histoire de la visibilité lesbienne en france, lire de Brigitte Boucheron "La visibilité lesbienne en France, it’s a long way " , Lesbia Magazine, N° de juillet-août 2005. Panoramique extra-documenté en version remaniée et élargie de "France, années 90 : la décennie lesbienne " , conférence donnée en 1999 au Séminaire Orientation et identités sexuelles, questions de genre - Équipe Simone, conceptualisation et communication de la recherche/femmes, université Toulouse-Le Mirail.
2-Déjà fait on dirait (ouf ! les lesbiennes polonaises n’ont même eu besoin de l’étape laborieuse du féminisme, elles/ils -puisqu’il faut les associer aux GBT -, sont passé-es directement au queer) : les 18-20 septembre 2005 à Bielsko-Biala, se tiendra le colloque : Queer community/ies, queer exclusion/s
3- In Questions féministes, mai 1980, n°8 ; - The Straight mind and others essays, Beacon Press, 1992, rééd. dans Monique Wittig, La pensée straight, Balland, 2001.
4-Voir Danielle Charest, " Intégrationisme : les contrats apparentés au mariage. Une fuite en arrière " in lesbianisme et féminisme, éds. N. Chetcuti et C. Michard, L’Harmattan, 2003. Et communication au colloque de Rome, " Le sujet lesbienne " , mai 2005.
5- Voir aussi Brigitte Boucheron (article cité note 1), qui commente ainsi la triste acculturation lesbienne : " Trop de lesbiennes sont acculturées, phagocytées par la culture hétérosexuelle et gay, trop peu souhaitent l’existence d’une culture lesbienne, trop peu sont porteuses d’une ambition lesbienne, trop peu souhaitent autre chose que l’aménagement d’un " territoire intérieur " , confortablement interné en l’hétérosexualité. "
6-Rosanna Fiocchetto, Phénoménologie et pratique de la fureur. Amazones d’hier et d’aujourd’hui (voir espace lesbien n°4, mais sa communication romaine au colloque de mai 2005 a été enrichie par un commentaire raisonné de la situation italienne en 2005)
7- Brigitte Boucheron, article cité.
8-Gay & Lesbian Pride de Bari, 6 juin 2003 (les desiderandae m’y avaient invitée pour "raconter Bagdam"). En Italie les fiertés nationales sont chaque année organisées par une (grande) ville différente. En 2000 ce fut à Rome (fierté nationale et mondiale) et malgré les intimidations et menaces pour la faire interdire (ou plutôt grâce à cela), cette Fierté s’est transformée en gigantesque manif ( 500 000 personnes !) de tous les laïques et gauche hétéro confondus et cette fois solidaires pour faire la nique au jubilé fondamentaliste catholique romain. Cette année 2005, ce sera à Milan, et il semble que cette Fierté soit organisée par le mainstream (droit au Pacs, enfants, etc.). D’où la colère de nos amies lesbiennes séparatistes, organisatrices du colloque de Rome.
9- Lire à ce sujet, et concernant l’Italie, Simonetta Spinelli, "L’espace du désir" : la réception de l’oeuvre de Wittig en Italie" , in Parce que les lesbiennes ne sont pas des femmes, eds M.-H.Bourcier et S. Robichon.,éd. gaies et lesbiennes, Paris, 2002.)
10-Concernant l’accès à nos oeuvres, difficultés de tous ordre dont les causes principales sont la mauvaise volonté éditoriale (même Le puits de solitude de Radclife Hall n’est pas réedité, alors que ce classique devrait être en livre de poche !) et le manque de moyens que nous investissons pour nous éditer et nous diffuser. En Italie, Wittig est introuvable et pratiquement impubliée. Voir Simonetta Spinelli, article cité.
11-Audre Lorde, Sister Outsider, The Crossing Press Feminist Series, Freedom California, 1984 ; - Sister Outsider, Essais et propos d’Audre Lorde sur la poésie, l’érotisme, le racisme, le sexisme,.éd. Mamamélis (Genève, CH) et Trois (Laval, Canada), 2001.
12-Danielle Charest, article cité et communication au colloque de Rome, " le sujet lesbienne " , mai 2005.
13- Modèle du genre et dernier en date (mai 2005, sur TV5) : Mes questions sur... des femmes qui aiment les femmes, de Serge Moati. Fascination morbide de l’hétéromasculinisme, transpiration de curiosité agressive, le tout criblé d’arrogance et confondant d’ignorance. Mais, deux exceptionnelles exceptions à la règle : en étroite collaboration avec Bagdam Cafée, La sexualité lesbienne, de Catherine Muller-Feuga, France3-Sud, 1996, avec Marie-Jo Bonnet, Michèle Causse, Jacqueline Julien. L’autre divine surprise, ultra-récente, est le film réalisé par Michèle Causse, de Michel Garcia-Luna, Un écrivain en terres occupées, 50’. Bijou de didactisme sur le lesbianisme radical et le chantier entrepris par Michèle Causse sur le langage. Un DVD à commander : Luna.prod@wanadoo.fr
14-Tolérance repressive " (...) par laquelle les dominants, loin d’abandonner leurs tentatives d’imposer leurs normes, font mine d’accepter les différences pour mieux les contrôler " . Brigitte Boucheron, article cité.
15- Edda Billi, lesbienne féministe italienne " historique " , responsable administrative de la Casa internazionale delle Donne de Rome.
16- Voir à ce sujet la communication de Luki Massa qui rappelle sa stupéfaction consternée lors de la Fierté nationale italienne à Naples en 1996, où plusieurs associations lesbiennes proclamèrent (fièrement !) leur "normalité " (slogans chantés et banderoles).
17-Teresa de Lauretis : ce concept de la " presumption of heterosexuality " chez les femmes, figure entre autres dans son article " Quand les lesbiennes n’étaient pas des femmes " , in Parce que les lesbiennes ne sont pas des femmes, eds. M.-H Bourcier et S. Robichon, éd. gaies et lesbiennes, Paris, 2002. En Français, c’est hélas le seul article accessible de cette grande théoricienne italienne enseignant aux Etats-unis, dont l’oeuvre est traduite dans de nombreuses langues. Voir note 10.
18-Catherine Ecarnot, L’écriture de Monique Wittig. A la couleur de Sapho, L’Harmattan, 2002. Voir aussi sur ces sujets la brillante anthologie qui vient de paraître en anglais (fevrier 2005), éditée par Namascar Shaktini : On Monique Wittig Theorical, Political, and literary essaysed. Namascar Shaktini University of Ilinois Press, Urbana & Chicago, 2005. www.press.uillinois.edu Catherine Ecarnot et Namascar Shaktini ont toutes deux été intervenantes au 3e colloque de Bagdam (2002). Leurs superbes communications sur Monique Wittig sont à lire dans Espace lesbien n°3, " Le sexe sur le bout de la langue " , Bagdam Espace édition, sept. 2002.
19-Michèle Causse, L’interloquée, Les oubliées de l’oubli, Dé/générée, éd Trois, laval, Québec, Canada, 1991.
20-Katy Barasc, " Généalogie du mot lesbienne. Du subir au jouir " in Espace lesbien n°4, Fureur et Jubilation, Bagdam Espace édition, oct. 2004. Et communication au colloque de Rome, Le sujet lesbienne, mai 2005.
21-Françoise Armengaud, Avertissement à L’interloquée, op. cit.
22- Judith Butler, " Changer de sujet : la resignification radicale " in Humain, inhumain. Le travail critique des normes. Entretiens, éd. Amsterdam, Paris, 2005.
23-L’interloquée, op.cit.
24- Nicole Brossard, Picture Theory, Ed. Nouvelle Optique, 1982, rééd. L’Hexagone, Montréal, Québec, Canada, 1989.
Andrea Dworkin sur la danse-contact (ou Lap-dance)
Andrea Dworkin sur la danse-contact (ou Lap-dance)
source : http://netfemmes.cdeacf.ca/
Voici un texte d’Andrea Dworkin, féministe américaine, publié le 2 août 2002 dans le journal The Herald, de Glasgow (Écosse). Dans cette ville, des féministes ont réussi - après un long travail - à faire reconnaître comme dégradante pour les femmes la pratique prostitutionnelle de la "danse-contact" (lap-dance).
Andrea Dworkin est l’auteur de plusieurs livres importants : Scapegoat : The Jews, Israel, and Women’s Liberation ; Intercourse, Pornography : Men Possessing Women. Son dernier livre est : Heartbreak : The Political Memoir of a Feminist Militant.
traduction d’Annick Boisset
Il faut remercier Glasgow. Grâce à des organisations féministes efficaces, et travaillant ensemble depuis 30 ans à l’égalité et à la dignité des femmes, un nouveau discours est parvenu jusqu’à certains politiques. Sensibles à l’affront que la danse-contact représente pour l’intégrité des femmes, ils sont décidés à l’interdire. L’objectivisation des femmes est reconnue pour ce qu’elle est : la déshumanisation d’un groupe inférieur en vue d’une domination sexuelle et sociale. La marchandisation de la sexualité féminine est reconnue pour ce qu’elle est : l’utilisation insultante du corps des femmes considérées comme des produits de consommation de masse. La dansecontact est vue pour ce qu’elle est : de la pornographie vivante. La lutte pour cette prise de conscience a été longue et difficile. Elle est maintenant relayée par le conseil municipal et une commission de censure. L’idée que l’exploitation sexuelle est incompatible avec l’égalité est reconnue et partagée par un groupe de personnalités en vue. Ces personnalités ont fait preuve de courage en refusant de céder aux pressions de ceux qui organisent la danse-contact, et des "viandards" qui la consomment.
Le premier problème est celui du statut des femmes, qui sont inévitablement rabaissées, et traitées comme des sous-êtres, ou des objets à plus ou moins mal utiliser. Ce n’est que lorsqu’on défend l’objectivisation sexuelle dans la prostitution, et dans les phénomènes parallèles (danse-contact, strip-tease, pornographie) que les femmes peuvent devenir des "adultes consentantes". Dés lors, si elles abandonnent leur corps pour de l’argent, c’est la preuve de leur assentiment.
En Californie, un certain Lawrence Singleton a violé une adolescente et lui a coupé les bras ; pour finir, il a jeté un billet de 10 dollars sur son corps agonisant. Elle était d’accord, a-t-il dit, et il espérait clairement que cette largesse prouverait son consentement. S’il ne lui avait pas coupé les bras, le billet de 10 dollars aurait pu lui valoir un acquittement.
Quand le Marquis de Sade agressait et empoisonnait des prostituées, l’échange d’argent était (et est toujours) considéré comme une preuve de consentement. Si le marquis était poursuivi pour violence caractérisée par l’une de ses victimes non prostituée, et qu’elle acceptait un dédommagement financier, elle prouvait par là le vice de sa nature : elle n’avait que ce qu’elle méritait. Elle faisait plus que consentir : Il abusait d’elle parce qu’elle le voulait bien ...afin de recevoir de l’argent .
De nos jours, la même arithmétique a cours quotidiennement dans les tribunaux américains. L’argent payé pour un rapport sexuel lave l’homme de toute responsabilité : on considère que la femme a consenti à tout ce qui lui est arrivé, ou qu’elle l’a cherché.
Le conseil municipal de Glasgow, ainsi que le comité de censure ont refusé d’accepter cet axiome patiarcal. A la place, ils se sont préoccupés du sort de toutes les femmes, y compris de celles qui pratiquent la danse-contact. L’exploitation sexuelle commerciale a été considérée comme la porte ouverte à toutes les violences contre les femmes.
Les hommes n’ont tout de même pas été jusqu’à justifier l’exploitation des plus faibles par l’argent.
Des gens, que je considère comme des exploiteurs, proclament que des femmes de la classe moyenne se précipitent aux hyper-marchés du sexe ; pourtant, la danse-contact est d’abord pour les pauvres, les malmenées, les sans-espoir. Ce prétendu travail est plus harassant et plus fastidieux que n’importe quel travail à la chaîne. De plus, il y a la question de la vulnérabilité : celles qui sont dénudées sont vulnérables, ceux qui sont habillés et qui agitent des billets de banque ne le sont pas. Sans compter que les hommes sont si grands et si forts !
L’argument toujours mis en avant en faveur de la danse-contact est d’ordre économique. Même si les femmes en général ne veulent pas être pauvres, elles sont pauvres malgré tout. Les danseuses-contact sont considérées comme des travailleuses indépendantes. Elles paient 80 dollars la nuit, plus 15% sur leurs pourboires, pour le privilège d’être un produit sexuel. On dit qu’elles gagnent la grasse somme de 25.000 dollars par an.
Toute femme, dit le mouvement féministe, est à un homme de distance du bien-être physique et moral. Pour les danseuses-contact, il faut bien plus qu’un homme. Les femmes ayant les mêmes métiers que les hommes sont toujours moins bien payées que leurs homologues masculins.
Mais personne ne pourrait envisager une épidémie de danse-contact masculine.
Certaines formes de dégradation sont exclusivement féminines.
Comme pour la plupart des soi-disant travailleuses du sexe, les danseuses-contact sont plus près du servage que de la "cochonocratie" capitaliste.
Il est difficile d’imaginer le temps où les hommes ne trouveront plus de moyens pour exploiter le corps des femmes, en vue de leur divertissement sexuel.
La danse-contact est la folie du jour, à un cheveu de la prostitution, ou combinée à elle. Il vaudrait sans doute mieux réhabiliter les combats publics d’ours et de chiens, plutôt que de faire de chaque entrecuisse masculine un royaume au dessus duquel des serves glamour donnent un spectacle de danse pour lui apporter le plaisir de la nudité pornographique en action. Pour lui, rien que pour lui. ...le roi du monde !
La prolétaire sexuelle doit le convaincre qu’elle est sur son entrecuisse, à lui, seul et unique au monde, parce qu’elle a envie d’y être. Voyez-vous, son entrecuisse n’est pas celui de n’importe qui, puisqu’à chaque fois, elle doit passer par l’épreuve de lui donner deux fois sa taille normale. Virginia Woolf n’imaginait pas qu’un homme puisse avoir un miroir de ce genre, des femmes vivantes, nues et dansantes ...grâce auxquelles il s’élargit et se met en valeur.
C’est une mécanique gourmande, ce consommateur d’autres êtres humains vivants. Il pense que les femmes n’ existent que pour lui ; le nouveau jeu, en ville, est qu’elles doivent se rapprocher le plus près possible de son pénis en érection, sans le toucher ; il leur donne alors l’argent. Dans les règles de ce jeu, l’homme évolue entre impuissance et masturbation. Bien sûr, la logique implicite est que la femme touche quand même, s’il le lui demande ; et alors, juste à ce moment, elle reçoit une somme d’argent supplémentaire : elle a franchi la frontière. De danseuse, elle devient prostituée, une femme authentiquement en marge, qui fera, et à qui l’on peut faire, n’importe quoi.
La danse-contact est l’avant-dernier échelon de l’echelle, la prostitution en est le dernier.
La chute est inévitable, car la danse-contact est le prologue, et non l’événement principal. Les hommes sont excités par la nouveauté, par le surgissement de cette nudité pornographique et vivante tout près d’eux : des inconnues femelles, et purement sexuelles, n’attendant rien d’autre que quelques billets. Les hommes sont excités par leur propre comportement, la domination "des filles" par l’argent qu’ils ont, eux, et que "les filles" n’ont pas. Chaque homme, pris individuellement, est le roi du monde quand il fait briller le fric !
Pour être défenseur ou amateur de danse-contact, un homme doit croire qu’il est lui-même une fascinante image sexuelle. Ainsi, il lui est possible de dire qu’il répond au désir de la femme d’être nue et d’onduler pour lui.
L’arrogance de la présomption est inouïe. Il devrait être évident que la succession des hommes, l’un après l’autre, provoque un ennui profond ; mais apparemment, en même temps qu’il célèbre son propre charisme, l’homme pense que les femmes n’ont ni cerveau, ni coeur, ni vie digne d’être vécue. Il croit qu’il se suffit à lui-même, qu’il a suffisamment de rationalité, et qu’il peut de ce fait la condamner à une existence dégradée.
Pourtant, s’il accepte de voir une femme comme un produit sexuel , cela signifie que l’homme en question n’a ni cerveau, ni coeur, ni vie digne d’être vécue.
Pensez-y. L’idiot moyen (en incluant dans cette catégorie les hommes haut placés qui utilisent des danseuses-contact) a un droit, que lui et ses semblables revendiquent, celui de se servir de la vie d’une femme, de la faire le toucher ou non à sa guise, de l’avoir devant lui, nue et ondulante, en s’appropriant sa sexualité pour de l’argent... Pas seulement sa sexualité, mais aussi son envie de vivre, son énergie vitale, des années de sa vie. C’est comme si finalement on avait laissé sortir l’ours de sa cage, parce qu’on aurait appris à un autre groupe d’ours à lécher, et non à mordre.
Les femmes en question sont des rebuts humains, et la plupart finissent vraiment comme prostituées. Les mêmes hommes leur rendent visite, et ils jouent maintenant un rôle plus dur, plus violent, plus dépravé. Dans la danse-contact, comme dans la prostitution, l’homme a l’illusion d’avoir acheté le corps féminin. Elle est à lui pour trois minutes, ou cinq, ou 10. Il a l’illusion d’avoir le droit d’acheter ce corps.
Il ne se sent pas responsable de ce qui arrive par la suite à ce corps qu’il a fini de besogner : "elle" est une chose, et son corps lui tient lieu d’humanité.
On doit se poser la question : les hommes sont-ils stupides à ce point ?
On prend alors conscience du principe sinistre qui préside à la tranformation de tous ces garçons ordinaires en hommes nuisibles, mais satisfaits. Faire du corps humain une marchandise est le principe de base de toutes les formes de cruauté systématique : le trafic des femmes, la vente d’esclaves au Soudan, l’utilisation de la violence contre un autre groupe, identifié par sa race, son genre, son identité nationale ou sa classe sociale. Les hommes courageux et forts qui sont adeptes de la danse-contact, pourraient le cas échéant se livrer à la danse du couteau à découper...
Andrea Dworkin
jeudi 15 novembre 2007
la sexualité exige-t-elle la domination pour s’incrire comme sensation ?... Andrea Dworkin répond
Andrea Dworkin ne croit pas que tout rapport sexuel hétéro est un viol
Traduction de l’article de C. Johnson par M.Dufresne
jeudi 10 août 2006
par Charles Johnson
source : chiennes de garde
Rad Geek (Charles Johnson) est un webmestre proféministe qui, tous les lundis, démantèle dans sa chronique Internet « Mythe historique du lundi » une légende urbaine, un « mythe » aussi répandu que factice. En 2005, il s’est penché sur une notion uniformément attribuée à Andrea Dworkin.
Aujourd’hui, ma chronique « Mythe historique du lundi » fait un peu le pont entre le passé et l’actualité.
Le mythe en question est la scie éculée mais continuellement rabâchée selon laquelle Andrea Dworkin prétendrait que tout rapport sexuel hétéro est un viol. Eh ! bien non, elle ne prétend pas cela ; elle ne l’a jamais écrit ou dit, et l’a nié explicitement quand on lui a posé la question directement. Ce mythe est historique, en un sens, puisqu’il concerne l’issue de certains écrits clés du féminisme de la deuxième vague, durant les décennies 1970 et 1980. Il est d’actualité dans la mesure où le récent décès d’Andrea Dworkin (9 avril 2005) semble avoir relancé pour un tour cette affirmation idiote, qui continue à faire surface sans égard au nombre de fois où elle est démentie. Mais qu’on le perçoive comme du passé ou du présent, ce mythe demeure pure foutaise.
Si tant est qu’ils prennent la peine de citer quoi que ce soit de son oeuvre - ce qu’ils ne font habituellement pas - les diffamateurs de Dworkin citent habituellement hors de contexte une phrase de son livre Intercourse, habituellement, par exemple, quelque chose comme cet extrait :
« Un être humain a un corps qui est inviolé, et quand il est violé, il est agressé. Une femme a un corps qui est pénétré dans le coït ; perméable, sa solidité corporelle est un leurre. Le discours de la vérité masculine - la littérature, la science, la philosophie, la pornographie - appelle cette pénétration une violation. Il le fait avec une certaine cohérence et une certaine confiance. La violation est un synonyme pour le coït. En même temps, la pénétration est considérée comme une utilisation, pas un abus ; une utilisation normale ; il est approprié d’entrer en elle, de pousser à travers (« violer ») les limites de son corps. Elle est humaine, bien sûr, mais selon une norme qui n’inclut pas la vie privée physique. Elle est, en fait, humaine selon une norme qui forclos la vie privée physique, puisque tenir tout homme à l’extérieur pour de bon et pour la vie est déviant à l’extrême, une psychopathologie, une répudiation de la façon dont elle est censée manifester son humanité. »
- Andrea Dworkin, Intercourse, chapitre 7
Ou celui-ci :
« Mais la hiérarchie viriarcale des genres semble immunisée contre toute réforme, qu’elle soit justifiée par la raison ou par une vision ou par des changements de styles sexuels, soit personnels, soit sociaux. Cela tient peut-être à ce que le coït est lui-même immunisé contre toute réforme. La femme y est l’inférieure, stigmatisée. Le coït demeure un moyen ou le moyen d’inférioriser physiologiquement une femme : en lui communiquant cellule par cellule son statut d’infériorité, en le lui inculquant, en l’imprimant en elle par scarification, poussant et poussant sans relâche jusqu’à ce qu’elle cède - ce que le lexique mâle qualifie d’« abandon ». Dans l’expérience du coït, elle perd la capacité d’intégrité parce que son corps - fondement de la vie privée et de la liberté dans le monde matériel pour tous les êtres humains - est pénétré et occupé ; les limites de son corps physique sont - pour parler de façon neutre - violées. Ce qui lui est enlevé dans cet acte n’est pas récupérable, et elle passe sa vie - voulant, après tout, obtenir quelque chose - à faire semblant que le plaisir tient à être réduite à l’insignifiance par le biais du coït. »
- Andrea Dworkin, Intercourse, chapitre 7
Mais interpréter ces passages pour prétendre que Dworkin croit que tout rapport sexuel hétéro (ou tout coït) est un viol équivaut à un malentendu - soit parce que le lecteur ou la lectrice ne se voit servir que des passages comme ceux-là, hors contexte, dans un catalogue du genre ‘musée des horreurs’, soit parce qu’elle ou il n’accorde pas à Dworkin la générosité d’interprétation qu’elle ou il aurait n’importe qui d’autre. Ces deux conditions semblent hélas très communes ; de ce fait, les énoncés faits par Dworkin au sujet de la signification du coït sont couramment interprétés à tort comme des énoncés faits de sa propre voix (in propria voce) quand il s’agit en fait d’énoncés sur la signification attribuée au coït par la culture viriarcale (male-supremacist) et imposée par les conditions matérielles (vulnérabilité économique, violence) que vivent les femmes sous le patriarcat. Il s’agit de significations que Dworkin entend critiquer, entre autres choses. (Toute personne qui a dû rédiger une exposition détaillée d’une perspective systématique dont elle disconvient pourrait probablement être interprétée à tort de la même façon.)
L’argumentation que déploie Dworkin dans Intercourse ne dit pas que les caractéristiques anatomiques du coït en font l’équivalent d’une coercition. Dworkin n’a aucune tolérance pour l’essentialisme biologique - ce que devrait savoir toute personne ayant lu des essais comme son « Biological Superiority : The World’s Most Dangerous and Deadly Idea ». Intercourse n’est pas un manuel d’anatomie ; c’est un examen du coït comme pratique sociale et comme expérience vécue pour les femmes, dans les conditions culturelles et matérielles d’une société viriarcale. Lorsqu’elle décrit le coït comme, par exemple, une occupation, elle ne veut pas dire que l’acte biologique lui-même implique une occupation ; elle parle du coït comme il est constamment dépeint dans une culture viriarcale et comme il est constamment agi dans une société où le viol et une sexualité phallocentrique sont défendus à l’extrême, excusés culturellement et même valorisés. Cela ne signifie pas que l’égalité exige la fin du plaisir sexuel ou, spécifiquement, du coït hétérosexuel ; cela signifie qu’elle exige un changement radical de la façon dont il est pensé et approché (Dworkin soutient que cela impliquera, entre autres, une sexualité qui ne soit pas centrée sur le coït de façon monomaniaque ; mais ça, c’est une autre revendication).
Dans des passages comme le second, Dworkin répond aussi aux libéraux sexuels (sexual liberals) et à certaines féministes (dans ce cas, Victoria Woodhull) qui posent plus ou moins en principe la légitimité de la sexualité centrée sur le coït et du coït tel qu’il est couramment pratiqué - et qui tentent de résumer toute perspective éthique sur la question à une discussion strictement limitée au consentement formel ou (dans le cas de Woodhull) à quelque notion plus robuste de l’autonomie sexuelle des femmes, et cela sans contester la centralité culturelle du coït ou la façon dont le coït est systématiquement façonné et mandaté par les conditions culturelles et matérielles environnantes que les hommes imposent aux femmes dans une société patriarcale. C’est une question de contexte ; et en parlant du coït tout autant qu’en lisant le livre, le contexte ne devrait pas être mis de côté comme tactique pour imposer ses vues, quelles qu’elles soient.
Si je devais tenter de résumer brièvement ce que dit Dworkin, je proposerais le digest suivant, beaucoup trop sommaire, de ses principales thèses. Elle dit :
- 1 que la culture patriarcale fait du coït hétérosexuel l’activité paradigmatique de toute sexualité ; les autres formes de sexualité sont habituellement traitées comme « pas de la véritable sexualité » ou comme de simples préliminaires au coït, constamment discutées en des termes qui les limitent à une comparaison au coït ;
- 2 que le coït hétérosexuel est typiquement décrit de façons systématiquement phallocentriques qui dépeignent cette activité comme initiée par et pour l’homme (comme la « pénétration » de la femme par l’homme, plutôt que comme l’« engloutissement » de l’homme par la femme, ou le fait pour la femme et l’homme de « se joindre » - cette dernière idée est représentée par le mot « copulation », mais celui-ci est rarement utilisé dans le langage courant au sujet des hommes et des femmes) ;
- 3 que les attitudes culturelles reflètent et renforcent des réalités matérielles comme la prévalence de la violence exercée contre les femmes et la vulnérabilité de beaucoup de femmes à la pauvreté extrême, réalités qui contraignent substantiellement les choix des femmes en ce qui concerne la sexualité et particulièrement le coït hétérosexuel ;
- 4 que les éléments (1) à (3) constituent un obstacle sérieux au contrôle des femmes sur leurs vies et leurs identités, obstacle à la fois très intime et très difficile à surmonter ;
- 5que le coït tel qu’il est actuellement pratiqué a lieu dans le contexte social des éléments (1) à (3) et donc que le coït, à titre d’institution sociale réelle et d’expérience réelle dans les vies individuelles des femmes, est façonné et contraint par des forces politico-culturelles et non par le seul fait de choix individuels ;
- 6 donc, que le fait de réduire toute perspective éthique sur la sexualité au seul consentement formel individuel plutôt que de considérer les conditions culturelles et matérielles qui encadrent cette sexualité et ce consentement formel, empêche les libéraux et certaines féministes qui écrivent sur la sexualité de percevoir la vérité de (4) ;
que -7 ces personnes en viennent à collaborer, soit par négligence, soit par adhésion, avec le maintien de (1) à (3), au détriment de la libération des femmes ;
et - 8 que la politique féministe exige de contester ces écrits et (1) à (3), c’est-à-dire de contester le coït tel qu’il est habituellement pratiqué dans notre société. Cependant, bien que j’espère que ceci clarifie un peu les choses, vous devriez vraiment lire vous-même le livre pour comprendre ce qui se passe.
Ce mythe en est un qu’Andrea a combattu durant des années. Voilà ce qu’elle avait à en dire dans une entrevue accordée en 1995 à l’écrivain Michael Moorcock :
« Michael Moorcock : Après Right-Wing Women et Ice and Fire, vous avez écrit Intercourse. Un autre livre qui m’a aidé à clarifier des aspects confus de mes propres relations sexuelles. Vous soutenez que les attitudes en matière de coït conventionnel consacrent et perpétuent l’inégalité sexuelle. Plusieurs critiques vous ont accusée d’affirmer que tout coït était un viol. Je n’ai trouvé d’indice de cela nulle part dans le livre. Est-ce bien ce que vous disiez ?
Andrea Dworkin : Non, je ne disais pas cela et ne l’ai dit, ni à cette époque, ni jamais. Il y a une longue partie de Right-Wing Women dédiée au coït dans le mariage. Mon argument était que, tant que la loi autorise une exemption statutaire du mari de toute accusation de viol, aucune femme mariée n’est légalement protégée du viol. J’ai aussi soutenu, à partir d’une lecture de nos lois, que le mariage mandatait le coït - c’était obligatoire, un élément du contrat de mariage. Dans ces circonstances, ai-je dit, il était impossible d’envisager le coït dans le mariage comme l’acte libre d’une femme libre. J’ai dit que lorsque nous examinons la libération sexuelle et la loi, nous devons regarder non seulement quels actes sexuels sont interdits mais également quels sont ceux qui sont imposés.
Toute la question du coït comme expression ultime de la domination masculine pour notre culture en est venue à m’intéresser de plus en plus. Dans Intercourse, j’ai décidé d’approcher le sujet comme une pratique sociale, une réalité matérielle. Cela tient peut-être à mon histoire personnelle mais je crois que l’explication sociale de la calomnie selon laquelle j’associerais toute sexualité à un viol est différente et probablement simple. La plupart des hommes et bon nombre de femmes ressentent du plaisir sexuel dans l’inégalité. Comme le paradigme de la sexualité en a été un de conquête, de possession et de violation, je crois que beaucoup d’hommes sont convaincus d’avoir besoin d’un avantage injuste, qui à l’extrême serait appelé le viol. Je ne crois pas qu’ils en ont besoin. Je crois que le coït et le plaisir peuvent et vont tous deux survivre à l’égalité.
Il est important de dire, aussi, que les pornographes, et particulièrement Playboy, ont publié la calomnie ‘toute sexualité est un viol’ de façon répétée depuis des années, et elle a été reprise par d’autres publications comme Time qui, invité à justifier cette affirmation, n’a pu citer une seule source de cette assertion dans mon oeuvre. »
Et voici ce qu’elle et Nikki Craft ajoutent sur la page Web intitulée « Andrea Dworkin Lie Detector » :
« Dans une nouvelle préface à l’édition du dixième anniversaire d’Intercourse (1997), Andrea explique ce pourquoi ce livre continue à être interprété erronément, à son avis :
[Si] l’expérience sexuelle de quelqu’un a toujours été, sans exception, basée sur la domination - non seulement des actes manifestes mais aussi des a priori métaphysiques et ontologiques - comment peut-il lire ce livre ? La fin de la domination masculine signifierait - à l’esprit d’un tel homme - la fin de la sexualité. Si l’on a érotisé un écart de pouvoir qui autorise la force comme élément naturel et inévitable du coït, comment peut-on comprendre que ce livre ne dit pas que tous les hommes sont des violeurs ou que tout coït est un viol ? L’égalité dans le champ de la sexualité est une idée antisexuelle si la sexualité exige la domination pour s’inscrire comme sensation. Bien que cela m’attriste de le reconnaître, les limites du vieil Adam - et le pouvoir matériel qu’il possède encore, notamment dans le monde de l’édition et des médias - ont imposé des limites à la parole publique (tant celle des hommes que des femmes) au sujet de ce livre. [pages ix-x]. »
J’espère que ce texte a contribué un peu à éclaircir la question. Ce traitement peut sembler un brin superficiel, tant la question a déjà été traitée, par le web-magazine feministe, entre autres, et bien sûr par Andrea Dworkin elle-même (via les créations Web de Nikki Craft). Néanmoins, ce mythe ne cessant de resurgir, je crois que cela vaut la peine de continuer à river le clou et - à tout le moins - de rédiger quelque chose pour Google sur la question et de rendre un peu plus repérables par Google d’autres articles qui traitent du même problème. Si j’arrive à démanteler ce mythe dans la tête d’au moins une personne, je serai vraiment heureux ; et si j’arrive à convaincre une ou deux personnes de prendre la peine de lire Intercourse avant de se mettre à réclamer à hauts cris son autodafé, alors je serai tout à fait aux anges.
Auteur : Charles Johnson, le 10 janvier 2005
Texte original : Rad Geek People’s Daily
Ce texte a été traduit et légèrement adapté de l’anglais par Martin Dufresne et il est diffusé avec la permission de Charles Johnson, qui en autorise toute utilisation sans frais aux termes du protocole copyleft, à savoir que toute personne ayant en main le texte (dans ce cas-ci, sa traduction) est autorisée à en faire libre usage à condition d’en créditer l’auteur et de laisser le texte sous copyleft
De la prostitution et des viandards selon Florence Montreynaud
Je m’ insurge contre la vision fataliste de la prostitution.
"le plus vieux métier du monde" disent-ils de manière emphatique, et cynique, c’est la racine du mal/du mâle dans son rapport à l’argent, à la violence et au sexe, c’est le viol de l’autre, sa mort, la jouissance du/dans le/ mépris !
Oui ! Éduquer les hommes !
Lutter contre la banalisation obséquieusement obscène, contre les "parce que cela a toujours existé, alors.."
Et bien NON !
Avec ce genre de posture on est prêt à tout accepter, et la prostitution c’est bien l’inacceptable en soi !
Lutter contre la prostitution c’est lutter contre cette morgue de l’argent-Roi
C’est lutter contre cette violence extrème faite aux femmes
Lutter contre la prostitution c’est rendre sa dignité à l’humanité !
sémaphore
« Je paie, donc j’ai le droit… »
NON aux « viandards » !
La prostitution, ça NOUS regarde !
(tract rédigé par Florence Montreynaud )
Le corps d’un être humain n’est ni un jouet, ni un outil, ni une marchandise, parce qu’il n’est pas un objet : il est le corps d’une personne.
Les demandes des « viandards », ces millions d’hommes qui paient pour un acte sexuel, justifient la prostitution et les trafics, régis ou récupérés par des réseaux criminels internationaux.
Ces « viandards » sont nos pères, nos maris, nos frères, nos voisins. Ils louent l’accès à un sexe, à un corps humain ; ils ne se préoccupent pas de ce que la personne prostituée vit ou ressent ; ils la paient pour l’utiliser comme de la viande.
Que faire pour que nos fils et nos petits-fils ne deviennent pas des « viandards » ?
Disons NON à cette exploitation !
Enseignons aux garçons et aux hommes le respect de l’autre !
Demandons aux pouvoirs publics et à nos élu-es**
- d’affirmer leur volonté de lutter contre la prostitution de la sexualité.
- de donner aux personnes prostituées la protection qui leur est due en tant que victimes d’une violence spécifique.
- de lutter plus efficacement contre le proxénétisme et les réseaux
- de financer des recherches scientifiques sur le sujet si mal connu des « viandards », de ces hommes qui paient pour « ça ».
- d’organiser un ample travail de prévention, en particulier à destination des jeunes, afin que le recours à des actes sexuels payés diminue et tende à disparaître.
Nous espérons en l’amélioration de l’humanité.
Nous voulons un monde sans prostitution.
Utopie ?
« L’utopie d’aujourd’hui est la réalité de demain. » (Victor Hugo)
NON AUX « VIANDARDS » ! OUI AU RESPECT !
Se prostituer : est-ce l’un des droits humains ?
par Florence Montreynaud
source : http://encorefeministes.free.fr/
(texte paru dans l’Humanité du 5 sept.-02 sous le titre « Mon corps est à moi ? »)
« Mon corps est à moi, j’en fais ce que je veux », disent certaines femmes prostituées en revendiquant la dignité de leur « métier », et l’appellation de « travailleuse du sexe » ou de « vendeuse de services sexuels ». Peut-on pousser aussi loin la logique de la revendication féministe des années soixante-dix — le droit de disposer de son corps ? Si « mon corps est à moi », c’est dans la limite d’une acceptation sociale qui, en Occident, va croissant. Je n’ai pas le droit de sortir nue dans la rue, ni de déféquer en public, mais je peux me mutiler, et je peux me suicider. En revanche, le corps d’autrui ne m’appartient pas. Il est interdit de mutiler quelqu’un, ou de l’aider à se suicider.
Refuser un rapport sexuel non désiré est un droit humain, et la connaissance de ce droit est l’un des progrès de la conscience humaine dus aux féministes. Renoncer à ce droit, en vendant l’accès à son sexe sans désir, en traitant son propre corps comme un moyen, est un acte qui ne concerne pas seulement une personne. C’est un marché qui engage deux personnes et, au-delà d’elles, une société qui le tolère, l’organise ou l’interdit. C’est un échange qui touche à une valeur universelle : la dignité humaine.
Il y a en France des millions de « viandards », de ces hommes qui louent un orifice d’un autre corps, de femme, d’homme, ou d’enfant, sans se soucier de ce qui a amené à se prostituer des personnes à l’itinéraire souvent marqué par des violences. Acheter l’accès au corps d’autrui serait-il l’un des droits de l’homme, ou plutôt du mâle français ? L’argent donne-t-il tous les droits ? Non, car le corps humain ne peut pas faire l’objet d’un marché. Non, car le corps humain n’est pas une marchandise. C’est un principe du droit français : le corps humain est inaliénable, c’est-à-dire que nul ne peut ni le vendre, ni l’acheter, ni le louer, en totalité ou en partie. Le Conseil d’État a déclaré illégale la location d’utérus (les « mères porteuses »). Sur quels fondements pourrait-on admettre, et à plus forte raison organiser, la location d’un vagin, d’un anus ou d’une bouche, le commerce de viande humaine ? Louer un orifice de son corps pour un usage sexuel n’est ni un service ni un métier comme les autres.
Certains défendent le droit de se prostituer, et le nomment prostitution « libre » ; ils se limitent à condamner le fait d’être prostitué-e, appelé prostitution « forcée ». Pourtant, une exploitation indigne, même consentie, même présentée par la victime comme le résultat d’une décision personnelle, reste une exploitation indigne.
Que des femmes prostituées cherchent à renforcer leur estime d’elles-mêmes par des déclarations d’auto-valorisation, cela peut se comprendre. Quand des personnes non prostituées leur font écho, il arrive qu’elles se laissent duper par des proclamations d’indépendance, souvent fallacieuses, car aucune prostituée ne peut reconnaître en public qu’elle est sous la coupe de proxénètes. Un des exemples les plus frappants est celui d’Ulla, meneuse de la révolte des prostituées lyonnaises en 1975 ; elle prétendait se prostituer librement mais, quand elle changea de vie, elle s’étonna : « Comment avez-vous pu me croire ? »
Se prostituer ne peut pas être un droit. Le droit qu’il faut gagner pour tous les humains est celui de ne pas se prostituer, le droit de n’être pas prostitué-e, tout en obtenant que les personnes prostituées aient des droits en tant que personnes et non en tant que prostituées. Il faut affirmer le droit de se soustraire à l’exploitation sexuelle et aider ceux qui cherchent à y échapper.
Il faut contester le droit que se donnent certains, de par leur argent, d’accéder au sexe d’autres personnes. Il faut expliquer les causes premières de la prostitution : la demande des « viandards », et la marchandisation de la sexualité.
Il faut dire qu’une personne n’est pas une marchandise.
Une personne est une personne.
Florence Montreynaud
Comment nommer ceux qui paient pour « ça » ? Remplaçons le nom « client » par un mot péjoratif !
par Florence Montreynaud
article publié dans un numéro spécial de la revue No Pasaran !
(hors série n°2, déc. 02)
1. Attention, vocabulaire !
Prostitution, prostituées, clients sont des mots employés couramment. Cet article a pour objet de réfléchir au contenu du nom « client » et de proposer un autre mot.
Je définis la prostitution comme le fait d’échanger de l’argent (ou un objet ou un service) contre un acte sexuel, c’est-à-dire un acte mettant en jeu au moins un organe sexuel d’une personne. Je ne traite pas ici des actes de domination, consistant en des souffrances et des humiliations reçues (le plus souvent) ou infligées, dans le cadre de pratiques payantes de cruauté dites « sado-masochistes » (en abrégé « sm »).
Les personnes qui vendent un acte sexuel sont appelées prostituées : c’est le nom correct de la langue écrite, et il vient du mot latin signifiant exposer. À l’oral, un mot grossier et familier est plus courant : « pute », comme dans les expressions « aller aux putes », ou « aller voir une pute » ; « pute » est un mot péjoratif, et aussi une insulte fréquente, exemples : « sale pute ! », « fils de pute ! »
Comment nommer celui (un homme dans l’immense majorité des cas) qui achète un acte sexuel ? Le mot usuel est client ; c’est aussi celui qu’utilisent les personnes prostituées et les proxénètes (ceux qui les exploitent), car les noms d’argot micheton ou miché sont vieillis. En anglais, le mot courant à l’oral est john, nom péjoratif (qui est aussi le prénom équivalant à Jean) et à l’écrit consumer (consommateur) ; en suédois, le mot officiel est acheteur et le mot d’argot péjoratif se traduit par morue. En français, morue est un mot d’argot pour désigner une prostituée, parmi des centaines d’autres dont beaucoup sont usuels, tels putain ou pouffiasse, ou encore fille, si banalisé que l’on n’en sent plus la charge injurieuse ; d’autres, comme tapineuse ou amazone, sont spécialisés, et de même pour call-girl, dite aussi « pute de luxe ». On emploie aussi des euphémismes, comme professionnelle ou péripatéticienne.
En français, il n’y a pas de symétrie entre les noms usuels des deux personnes engagées dans un acte de prostitution : pour la prostituée, le péjoratif « pute » ; pour l’homme qui paie, le positif « client », alors qu’il n’existe pas de nom péjoratif courant.
2. Le mot « client »
Le mot « client » est positif, par exemple dans le slogan publicitaire « le client est roi ». Il est lié à des mots du registre commercial comme fournisseur, marchandises, paiement, tarifs, etc. ; ou à des notions d’économie comme offre et demande, marché, ou solvabilité. Employer le mot « client », c’est se placer, consciemment ou non, dans la logique de ce gigantesque marché mondial qui brasse des milliards d’euros (au moins dix milliards dans l’Union européenne), avec une demande – des désirs masculins - qui entraîne et justifie une offre, incarnée par des personnes, femmes, hommes ou enfants, vendant sans désir l’accès à leur sexe ou à un orifice de leur corps. En France, une partie des personnes prostituées – entre 10 % et 30 % selon les villes — sont des hommes, pour la plupart travestis en femmes, et ceux qui les paient sont en majorité hétérosexuels. La prostitution, à l’exception de celle des personnes de moins de dix-huit ans, est libre. Seul le proxénétisme (l’exploitation de la prostitution d’autrui) est interdit, mais les effectifs policiers sont insuffisants et les condamnations sont rares.
2.a. la violence
Employer le mot « client », c’est négliger, occulter ou nier la dimension de violence qui caractérise le système prostitutionnel. Aujourd’hui, l’opinion publique connaît mieux cet aspect, grâce aux nombreux reportages sur les réseaux criminels de proxénétisme, sur leurs méthodes de tortures ou de chantage, et sur l’enfer que vivent des millions de personnes prostituées à travers le monde. Nul ne peut plus prétendre, comme des savants il y a un siècle, que, si des êtres humains en arrivent à vendre l’accès à leur sexe, c’est parce que la forme de leur crâne prouve leur prédisposition congénitale au « vice » ! L’on sait bien aujourd’hui que ce n’est jamais de gaieté de cœur que des personnes prostituées font vingt « pipes » à la suite, encore moins jusqu’à une centaine de « passes » (rapports sexuels payants) par jour. Pour résister, elles recourent à l’alcool et aux drogues ; pendant la « passe », elles disent s’absenter de leur corps, dissocier leur corps de leur esprit. De même, le grand public dispose depuis peu de quelques informations sur les hommes qui paient des personnes prostituées, femmes ou hommes : ce sont en majorité des hommes mariés ou en ménage, de tous les milieux sociaux, d’où l’expression « Monsieur tout le monde », qui est trompeuse quant aux profils psychologiques de ces hommes. Autre lacune : l’on n’a pas assez pris conscience que les demandes de prostitution sont un puissant moteur pour le trafic : c’est parce que des hommes sont prêts à payer que l’on met à leur disposition d’autres êtres humains.
Négligeant la violence du système prostitutionnel, ceux qui emploient le mot « client » en connaissance de cause privilégient l’aspect économique de ce qu’ils nomment des « transactions sexuelles ».
La prostitution est-elle un commerce portant sur la fourniture d’un service comparable à d’autres qui concernent aussi le corps humain, par exemple des soins ou des traitements ? Une fellation est-elle analogue à un massage du genou, ou à une teinture des cheveux ? N’y a-t-il aucune différence de nature entre ces deux actes : pénétrer dans un taxi en demandant au chauffeur d’aller à tel endroit, et pénétrer dans une bouche ou dans un anus avec pour objectif d’éjaculer ?
2. b. un service commercial ?
Oui, un acte sexuel peut être assimilé à un service sexuel, disent ceux pour qui un donneur d’ordre commande une prestation, accepte ou négocie un tarif avec une personne fournisseuse qui s’exécute, et encourt des reproches si le « client » n’est pas satisfait. Ils nomment ces fournisseuses « travailleuses du sexe », en anglais sexworkers ; pour eux, la prostitution est un métier, et ils avancent des revendications de type syndical portant sur les droits sociaux, la sécurité des conditions de travail, le refus de la concurrence déloyale, etc.
Selon eux, pour faire disparaître la dissymétrie entre les mots « pute » et « client », il faut utiliser l’appellation « travailleuses du sexe », qui revaloriserait le statut de ces personnes, victimes de l’opprobre injustement attaché à leur « métier ».
Ils ne remettent pas en question la légitimité des demandes, qui leur semble évidente, et justifiée par la « nature », compte tenu de spécificités attribuées, pourtant sans aucun fondement scientifique, à la sexualité masculine – besoins irrésistibles, recherche de la nouveauté, disposition à la polygamie ou au vagabondage, etc. ; en réalité, celles-ci ne relèvent pas de la biologie, mais de la culture machiste qui légitime la domination masculine tout en contraignant les hommes à prouver sans cesse leur virilité.
Honteuses pour certains « clients », revendiquées comme un droit par d’autres, ces demandes tirent aussi leur légitimité de leur caractère très répandu : en recoupant les résultats de diverses enquêtes, j’estime qu’en Occident un homme sur deux a, au moins une fois dans sa vie, payé pour un acte sexuel, et qu’un homme sur dix paie régulièrement pour « ça ».
2. c. un acte et deux personnes
La prostitution est-elle un service commercial comme un autre ? Pour ceux qui répondent NON, ce qui est mon cas, et qui refusent cette démarche banalisant la violence, la dissymétrie entre les mots « pute » et « client » devrait être modifiée par l’emploi, d’une part de l’expression « personne prostituée » plutôt que « pute », d’autre part d’un mot péjoratif pour remplacer « client ». Alors que « client » cautionne la légitimité des demandes masculines, cette nouvelle désignation pourrait attirer l’attention sur le caractère égocentrique de ces hommes, relevant d’une irresponsabilité sociale, d’une immaturité affective et aussi parfois d’une pathologie.
Répondre NON procède en effet d’une tout autre analyse de la sexualité humaine et de la prostitution.
Un acte sexuel ne met pas en jeu seulement des organes, des sexes, c’est-à-dire des morceaux de corps humain ; cet acte ne se limite pas à la zone génitale : il est aussi une relation sexuelle qui engage pendant un certain temps, non seulement un ou des sexes, mais aussi des corps humains dans leur ensemble ; au-delà de cette dimension sensorielle et matérielle, cet acte engage des personnes ayant chacune leur sensibilité, leurs émotions, leur histoire, leur avenir.
2. d. une demande qui prend une forme sexuelle
Même si l’acte de prostitution concerne un ou des organes sexuels, il est, plus fondamentalement, un acte de domination qui prend une forme sexuelle. En achetant une disponibilité sexuelle momentanée, des hommes cherchent aussi à assouvir un désir de domination sur un autre être humain. Pour se libérer des contraintes de la séduction virile, pour atténuer leur peur de ne pas être à la hauteur, ils se donnent à peu de frais l’illusion de plaire ou d’être séduits. Souffrant de frustrations, d’un sentiment d’échec, de timidité, ils cherchent une compensation avec le seul pouvoir de leur argent.
« Je paie, j’ai le droit » : cet argent leur donne aussi la possibilité de matérialiser un fantasme, ou de satisfaire un désir qu’ils ne peuvent exprimer dans d’autres conditions ; ils le font sans souci des conséquences pour l’autre, en toute irresponsabilité.
J’ai eu des entretiens avec beaucoup de ces hommes, et j’ai interrogé des travailleurs sociaux et des psychothérapeutes sur ce sujet très mal connu. Je discerne trois traits communs à la grande majorité des hommes qui paient pour « ça » :
- un déficit de l’estime de soi, qui remonte à l’enfance et qui se traduit par un mal-être ; ils cherchent à y remédier par la satisfaction d’un désir, qui leur donne l’illusion momentanée d’un pouvoir. On trouve le même manque chez bien des violeurs, ainsi que chez des hommes qui sont violents avec leur compagne ou avec leurs enfants.
- un goût du risque, par exemple chez ceux, très nombreux, qui proposent de payer le double du tarif demandé pour une « passe » sans capote ; ou les hommes connus qui mettent leur réputation en danger, par exemple l’acteur Hugh Grant, arrêté à Hollywood en 1995 pour une fellation par une personne prostituée dans une voiture. Cela s’explique aussi par l’attrait de l’inconnu, dans le cadre d’une pratique dont le déroulement immuable est rassurant ; sauf pour une minorité d’« habitués », ces hommes s’adressent à des personnes qu’ils n’ont pas encore « essayées » ; d’où la rotation de « chair fraîche », l’évolution permanente de l’offre et le développement des trafics.
- un clivage dans leur représentation des femmes, entre les femmes bien, sans sexualité, apaisantes et toutes-puissantes, que l’on respecte, et les autres, les « salopes » hypersexuées, fascinantes et excitantes, qu’il est facile de mépriser ; d’un côté, l’épouse, « la mère de mes enfants », figure maternelle à qui, disent-ils, « je ne peux pas, ou je n’ose pas, demander ‘ça’ » ; de l’autre, les professionnelles de « ça », qu’ils paient pour du sexe alors qu’ils voudraient plutôt oublier solitude, souffrance, problèmes de communication, et se rassurer en dominant ; ces femmes chez qui ils cherchent à la fois à se consoler de leur malheur et à se confirmer leur virilité.
Ce clivage est d’autant plus difficile à dépasser qu’il relève du machisme traditionnel, avec sa distinction entre « la maman et la putain », entre les femmes que l’on aime sans les désirer et celles que l’on désire sans les aimer ; comme si le respect était incompatible avec le plaisir, comme si la sexualité était dégoûtante…
3. D’autres noms
Si l’on refuse l’alibi du système prostitutionnel, avec sa représentation d’un marché solvable et de demandes à satisfaire sans s’interroger sur leur légitimité ni sur la violence de l’ensemble, comment appeler ceux qui paient pour disposer sexuellement d’une autre personne ?
3.a. putanier, prostituant, acheteur de corps
Au 14° siècle, on les qualifiait en France de « putaniers », mot dont on trouve l’équivalent aujourd’hui dans l’espagnol putañero ; comme pute ou putain, ces mots viennent du mot latin qui a aussi donné puer, sentir mauvais ; c’est insister sur le caractère sale, répugnant, aux sens propre et figuré, attaché à la prostitution. Au début du XX° siècle, des féministes françaises ont suggéré un autre nom ; prostituée étant un participe passé, cela suppose l’existence d’un agent de l’action, celui dont la demande crée la prostitution : d’où leur proposition du nom « prostituant ». En Suède, le nom officiel est « acheteur de corps de femme ». Cette expression renseigne sur la nature de la transaction, même s’il s’agit d’une location plutôt que d’un achat ; elle n’a ni la brièveté si efficace du mot « pute », ni sa charge injurieuse.
3. b un nouveau nom
J’ai cherché un nouveau nom, aussi péjoratif que « pute ». Dans la rue, le marché conclu, après une brève négociation, s’exprime le plus souvent en quelques mots, du type « trente euros la pipe » ou « cinquante l’amour » (dans le langage de la prostitution, le sens le plus courant du mot amour est « rapport sexuel avec intromission du pénis dans le vagin »). Ce n’est pas une personne qui intéresse l’acheteur dans ce corps dont il paie ainsi la disponibilité momentanée, ce n’est même pas un corps humain dans sa totalité, c’est une partie de ce corps, un morceau de viande humaine. Je vois ces hommes comme des acheteurs à une exposition de « viande sur pied », dans une foire aux bestiaux, ou devant l’étal d’une boucherie où des étiquettes avec le prix au kilo sont piquées dans des pièces saignantes.
Je me suis rappelé les paroles d’une femme, aux États-Unis, qui avait réussi à sortir de la prostitution et qui avait trouvé du travail dans un restaurant Mac Donald. À quelqu’un lui disant : « Vous gagnez moins qu’avant ! », elle avait répondu : « La différence entre la prostitution et le Macdo, c’est que dans la prostitution c’est moi qui étais la viande. »
C’est pourquoi je propose le nom viandard.
En français, le suffixe –ard est péjoratif, par exemple dans criard, bavard, flemmard, traînard, tocard, etc., avec souvent une idée de grossièreté et de brutalité, comme dans soudard, charognard ou salopard.
Depuis les années soixante-dix, le mot viandard s’est répandu pour désigner une sorte de chasseurs peu estimée : un tueur d’animaux, sans états d’âme ni alibi écologique, pour qui seule compte la quantité de viande abattue. Abattage est un mot courant dans le domaine de la prostitution : il désigne une pratique qui consiste à faire subir à une femme des rapports sexuels avec de très nombreux hommes, plus de cent par jour.
Les viandards trouvent sans peine le gibier prostitutionnel, qui s’expose dans les rues, sur les routes ou dans les bars, dans les prétendus salons de massage, dans les pages des quotidiens régionaux, sur Internet, par minitel ou par téléphone. Ils peuvent se prendre pour des chasseurs, à l’affût dans une rue sombre, ou devant leur écran, avec le frisson de l’aventurier à la découverte d’un monde inconnu, excitant, dangereux.
Ils peuvent se faire des illusions sur le pouvoir que leur donne leur argent, mais ils sont surtout remarquables par leur égoïsme et par leur inconscience. S’ils entendaient les personnes prostituées parler d’eux ! Mépris, haine, dégoût pour leur saleté, pour leurs mauvaises odeurs, pour leurs problèmes minables, ou pour leurs idées « tordues » ; seul leur argent compte. Le prendre, leur donner ce qu’ils demandent, le plus vite possible, et se débarrasser de ces pauvres types !
Conclusion : la prostitution de la sexualité humaine
La loi suédoise entrée en vigueur en 1999 et qui pénalise les « acheteurs de corps de femmes » assimile la prostitution à une « violence masculine dirigée contre les femmes ». Il faudrait inclure les hommes, les garçons et les filles prostitués à des hommes, et les femmes de pays riches qui sont de plus en plus nombreuses à payer de jeunes hommes pour un acte sexuel, notamment dans les pays pauvres où elles vont passer des vacances.
Je propose d’élargir le débat : outre le trafic de personnes, femmes, hommes et enfants, il s’agit aussi de la prostitution de la sexualité humaine, assimilée à une marchandise et faisant l’objet d’un commerce.
En France, cette dégradation concerne à la fois la représentation grossière et violente de la sexualité humaine dans la pornographie, son instrumentalisation dans la publicité sexiste et dans les injures sexistes, et la situation abominable de la quasi-totalité des personnes prostituées.
La prostitution en chiffres, c’est 98 % de viandards et 2 % de personnes prostituées.
En France, j’estime à un ou deux millions le nombre de viandards réguliers. Selon la police, il y a environ 20 000 personnes prostituées à plein temps. Cela constitue à la fois une somme de drames individuels, un problème collectif traité de manière hypocrite, et un sujet sur lequel toute volonté politique fait défaut.
Depuis l’abolition de la réglementation en 1946 (appelée fermeture des « maisons closes »), il n’y a jamais eu de débat public sérieux sur cette question — est-ce lâcheté, complaisance, ou complicité ? — tandis que de puissants groupes de pression s’opposent toujours au développement à l’école d’une éducation à une sexualité responsable, comme il en existe en Suède.
Ce sont les demandes des viandards qui justifient les offres de prostitution. Leurs comportements sont socialement admis, voire encouragés, et de même pour les agissements et les discours de ceux qui traitent le corps d’autres êtres humains comme de la viande, objet d’un commerce aussi légitime qu’un autre.
Or cela s’appelle de l’esclavage, et ici de l’esclavage sexuel. Or cela est indigne. Un espoir ? En 2000, dans un texte de l’ONU, les États se sont engagés à prendre des mesures pour « décourager la demande ».
L’existence de dizaines de millions de viandards est un défi à l’humanité. Elle pose la question de la sexualité, dimension importante de l’être humain. Instrument de domination machiste, arme de violence et de mort par le viol ou par la prostitution, la sexualité peut aussi devenir, dans la liberté, l’échange et la gratuité, une source de plaisirs magnifiques.
Merci à Annick Boisset, Henri Boulbés, Clara Dominguez, Claudine Legardinier, Malka Marcovich et Valérie Montreynaud-Blavignac, pour leurs précieuses remarques ! Merci à Denise Pouillon-Falco et à Suzanne Képès, qui ont guidé les débuts de ma réflexion !
Florence Montreynaud
mai 2002